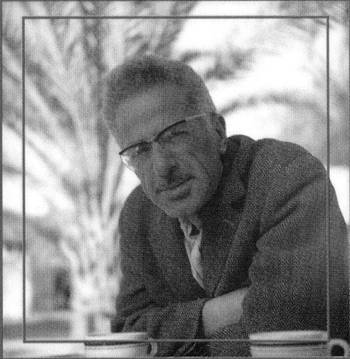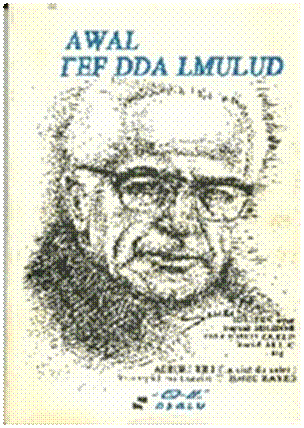ayamun
CyberRevue de littérature berbère
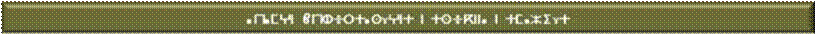
15 ème année
Numéro 74 Février 2015
Numéro spécial Mouloud Mammeri
Email
: ayamun@hotmail.com
Retour
à Bienvenue
Pétition
Prénoms algériens authentiques (mis à jour et augmenté)
Enfin un CLAVIER COMPLET :
http://www.ayamun.com/Tamazight.zip
Sommaire :
1°) Le texte en prose : ABEḤRI TILI, La cité du soleil yura Mulud At Mɛammer,Tiririn ɣer teqbaylit n sɣur Ḥmed Zayed,
Awal ɣer Dda-Lmulud, Asalu, furar 1990, , Ixf 1, amastan
2°) Létude
: Ameslay ɣef
tjegdit, par Salem IghilFalou, ayamun n°2, Juillet 2000
3°) L 'évocation : ...Iteddu akken yufa, maççi akken yebgha, par A.OUFREHAT,
EL_WATAN 27/03/95
4°) L'interview : Djaout, T. et Mammeri, M., 1987. Entretien avec Tahar Djaout : La Cité du
soleil, Alger Laphomic. 194 p.
(Extrait, pages 1 à 9)
5°) Six préfaces par Mouloud Mammeri
6°) Quatre portraits
de Mouloud Mammeri
7°) Une autre interview : interview de Mouloud Mammeri réalisée en février 1984 et
publiée dans "The Middle East magazine" par Chris Kutschera.
8°) Tidlisin nniḍen, en PDF :
9°) La conférence : : Mouloud MAMMERI, le défricheur de savoirs, par Ali Sayad, ayamun n°36, Novembre 2008
10°) Le poème : « ur t-cqan medden ma nnan » Sɣur Σ.Mezdad, 1989, ayamun n° 32,
Fevrier 2008
Retour
en haut
Numéro 74
Février 2015
Le texte en prose :
ABEḤRI
TILI,
La cité du
soleil yura Mulud At Mɛammer
Tiririn ɣer teqbaylit n sɣur Ḥmed Zayed
Tukkist seg Awal ɣer Dda-Lmuld, Asalu, Furar 1990
IXF I
AMASTAN
Ayen yelhan deg wussan n Héliopolis d udem-nsen ur
nettbeddil ara : yal wa yesrus aḍar-is anda i t-yekkes gma-s, medden akk ẓran
ayen ara yeḍrun gar-asen d taggara wass. Ulac ayen ara d-yennulfun deg
wussan n Héliopo1is. Dimi imdanen akk ires wallaɣ-nsen.
Yal ass yettawi-d uguren imezyanen, maca d uguren
yettwassnen, d nutni i-yettakken tebnen i wussan
yilmeẓyen, ussan berriken. Lemmer mačči d
tebnen-agi, tili rewlen akk ɣef tigduda. Ilmeẓyen n Tegduda
yečča-ten uɣbel n tudert di tmura niḍen akk d trewla.
Di Héliopolis, tikeryas qlilit, yal ass
ččurent, ttasent-d ma d asent-yehwu; di Héliopolis,d agani zdat Yaɛricen
di leswaq akk d tḥuna; di Héliopolis, deg wussan iḥuccan ttfugun i
yigij.
Lemmer mačči d tikli sya ɣer da, d ugani
akk d udummu,wissen d acu ara gen imezday n Héliopolis deg wussan-nsen ?
Yema ẓran yella "Wegraw wwufrinen" yettɛassa
fell-asen. Ufrinen-agi ttwafernen sɣur irebbiten. Acku tamusni wwufrinen
ur tessefk ara i weɣref ameɛlal ad aten-id-yefren. Ad d-yefren agraw
ad as-d-yawin ussan ijuǧǧgen!
Agraw wwufrinen yettnejmaɛ deg udrum ufella n
temdint, dinna ur yeggit ara ubeḥri maca d azedgan. Ur ten-yettaweḍ
ara uḥretwir iderma wwadda, acku tettruẓu tsawent akk d taɛli.
Ufrinen ttɛassan ɣef lehna yemdanen n
Héliopolis, acku d numi i yttmeslayen d irebbiten.
Tazmert-nsen meqret, tajmilt-nsen ur tettruẓ ara.
Imdanen akk ssnen ismawen-nsen, ẓran d acu i d axeddim-nsen, maca yiwen
ur ten yettwali acku tunez-iten lehna wweyref; iḍ d wass nutni d annuz
almi ur zmiren ara ad d-ḍeggren tiṭ fell-as.
Akud-nsen d agerruj, ulamek i t-sruḥen d weyref.
Yerna tameslayt-nsen mačči yiwet.
Assaɣen-nsen d irebbiten srewlen-ten ɣef
tmeslayt n tmurt, deg yigenni ay Ilan.
Akken ad tazzel tikli-nsen, yal wa gar Wufrinen yeṭṭef
tajmilt-is, yella : Bu Texriṭ, Bu Wallaɣ Amezyan, Lqaḍi werjin
neɣliḍ, Bu Tikra uwɛir, Ameqran imeẓẓu1a, akk d Bu
Yetran. Sin agi ineggura ɣeṭllen-d targagayt ɣef yemdanen mara
slen i yisem-nsen.
Segmi ẓran Wufrinen d akken lehna tettekk-d si
laman, snulfan-d yiwet tallit di tmurt n Héliopolis.
Si tafrara alamma d aɣelluy yiṭij,
ttmeslayen-d lecyax i weyref, mmalen-as-d iberdan yelhan yettawin ɣer
lehna d tawant. Ur ttaǧǧan tiqit ad tengi; acku syin i d-itekk yir aḍu.
Tajmilt-nsen d tuzya d tmunda, yal takti ad att-id-meslen s meyya wudmawen, s
meyya wawalen, s meyya icewwiqen. Tikkwal ttarran-asen amezgun ara yeṭṭfen
kra wussan; di tegnitt-agi, selmaden-asen amek ara d-inin: Ilan di lehna d
tawant!
Ugur-nsen d tafakit! Amek ara d qqlen m'ara tfak tmenzut?
Maca Bu Wallaɣ Amezyan yenna-yasen-d ulac ɣer-s: ayagi
mačči d aṭan meqqren, d tawla tafessast ara s-yekksen i weyref
n Hé1iopo1is, asm' ara yaweḍ d ilemzi, asm' ara yaki d tilawt akk d taɣert
n tilli !!
Di tallit-agi d lehna i yeẓra Umastan d akken qqimen-as-d
kan kra iseggwasenlsemma i-yiman is
Amastan, netta Werjin yeɣri, yessen kan kra n
tmucuha, izzuzun yes-sent ul-is!
Ur yeẓri ara acuɣer i t-ɣaḍen
yemdanen-nni ara d-yeǧǧ deffir-s i wluɣu n tegnawt d waman!
Imdanen ur neẓri azekka-nsen, imdanen at tirga
mebla ixef!
Yiwen yiḍ yerẓa-t ɛawaz, yefra-tt d
yiman-is: ad ibedd ɣer yemdanen-agi, ad asen-d-yesken tidett; qbel ma
yewwi-ten wasif, qbel ma ttazzalen idammen s tannumi deg yiẓuran-nsen
yeqquren. Yettaḍsa deg yiḍ-nni almi yeqber, maca ala itran i s-d-yeslan!
Seg wassen yettɣama di temlilit iberdan, di leswaq,
deg yidurra ugani, di leqhawi ideg ggten wid i tessen; syin ad yebdu asuɣu:
- Ay imaruzen!...
Nutni ad skaden deg-s s wallen imaɛlal.
Simmal yettmeslay, simmal yeskan-asen-d ttwirat.
- Ay imaruzen! Snasel-nwen ẓẓayit,
ifadden-nwen d iɣunam!
Ney:
- Ay imaruzen yefri isulsen, zzit allen-nwen ɣer
tafat!
Ney:
- A wid tuɣ tullfa d tkerkas myuṭṭafet
ifassen, temyinim tidett qerrihen!
Ur ttaḍsan ara yakk, acku mačči yakk i
ssnen urar! Yerna amastan yettmeslay s lemɛani. Ma yella ad rnun yemdanen
lemɛani ɣer wulac d lbaṭata d uwren, a nger-ik ay-ul!
Tulawin ttaḍsant fell-as, irgazen sḥaḥayen-t
seg ubrid-nsen, arrac kkaten-t s yeḍɣaɣen. Kra sellen-as, yiwen
ur d as yesmuzgut s tidett-is.
D agguren, d iseggasen, netta yettmeslay aklan,
isekranen, imdanen niḍen, di leqhawi, di tjemmuyaɛ... netta s
ijerbuben akk d ttwirat i gerrezen.
Di tegwnitt-nni, tudert simmal tettɣar di
Héliopolis. Aɣrum simmal yettaɣlay, zzit texser, at lbiruwat kkaten
kan; Am akken imdanen inɣes fell-asen ubeḥri.
Imenza i d-yusan ad ẓren amastan d imeɣban ur
nelsi talaba.
Yenna-yasen:
- Ur teccidem ara kunwi i d-yusan ɣur-i? D acu ara
awen-d-fkeɣ? Ur d-ggrin izegza,wala iẓerman, wala irkasen n uglim i
warraw-nwen!
Nnan-as:
- Mačči d aya iɣer d-nusa!
- D acu tettnadim ɣur-i?
Rran-as:
- Ay Amastan! Susef ɣer tfidiwin-nneɣ ad ḥlunt.
- Isusfan d ammus, mačči d asafar iseḥluyen!
Nnan as:
- Xas akken deg waluḍ-a udmawen-nneɣ ur neswi,
akken ad asen-tekkseḍ tirnuɣbent i ten-ineṭḍen am
ujeǧǧiḍ!
Inna-yasen:
- Aṭan-nwen yekka-d si tɣawsiwin, maca yuɣ-d
aẓar seg-wen!
Segmi ur fhimen ara, yerna yenna-yasen:
- Tugdin d iɛebbaḍ-nwen ɣedlen-kun ugar n
tyitiwin udebbuz.
Yemrneslay-iten aṭas ɣef annect-a. Simmal
yettmeslay, simmal tezzin-d medden ad slen amzun d igelfan yizan ɣef
tament-nsen. Idammen ẓeqqelit i tikli deg uran-nsen, tamuɣli-nsen
terwi si tezweɣ wallen-nsen.
Syin,
mebla ma yenna-yasen Umastan, yal wa yettlummu ɣef yiman-is: tulawin
ireqqen am tziri cergent udmawen-nsent! Iwumi ccbaḥa du tudert am tin!
Irgazen uzmiren ceṭṭben tifḥulin ifassen-nsen, imi ur lhint i
kra!
Fran-tt ad
uẓumen ussan, uḍan akken ad xellsen tatut i ttun tidett am waman.
Imrefhen,
yucafen s tkerkas d yir tamuɣli, zdin ɣer-sen zunakit. Akken i
ten-yegzem fad nutni ttwalin deg waman iccercuren di tliwa tisemmaḍin,
gar tselnin.
Yal
učči yelhan ires-d zdat-sen akken ad at-ṛwun s tmuɣli,
syin ad aten-refden waklan imelluẓa. Kra wussan kan, llaẓ yesderɣel
at wartazmert; bdan alejlej. Aṭas wussan i ttmerrin, tamuɣli-nsen teččur
s wayen yelhan! Ttargun ijeǧǧigen di tlemmast n tniri.
Yenna-yasen
Umastan, wigi d widen iferḥen; acku mi jedben, Rebbi isufeɣ-asen
tayri d laman.
Mi d-ukin
widen yerẓa ujdab, ifuk Umastan tazwayt; isuref-asen ad ččen,
ad swen, ad gen tayri ɣef yiman-nsen. Syin isawel-asen di tezwayt tis
snat.
Nnan-as:
- Mmeslay!
Awalen-ik ad ayɣen deg wallaɣen-nneɣ am igeḍman n wurreɣ!
Awalen-ik ad ksun am tẓuyar di ddekir n timmuɣbent-nneɣ.
- Ay
imdanen! D tiɣawsiwin tesgam i kun-imelken!
Yenṭeq-d
yiwen yenna:
- Maca...
ur ɣumeɣ acemma! Neɣ a1a...ɣumeɣ
Cwiṭiṭuḥ!
Yenna-yas
Umastan :
- Cwiṭiṭuḥ-agi
d aṭas! Deggret-tt i yiḍan!
Yenḍeq-d
wayeḍ yenna:
-
Kečč la d aɣ-tesɣareḍ timmuɣbent yugaren timmuɣbent.
Yerra-yas
Umastan:
- Deggret ɣer
tzuliɣt tiɣawsiwin tesɛam ad at-teḍeggrem timmuɣbent-nwen
yid-sent!
Yenna-yas
urgaz:
- Waqila
tettiḥiyeḍ ay Amastan!
Imrefhen ḍeggren
kra igerrujen-nsen ɣer wasif n Héliopolis i ten-isawḍen ɣer
yillel.
Igellilen
ddmen d ijerbuben imeɣban akk d iberṭuten ilmetra qqlen-d, tamuɣli-nsen
yiwet.
Nnan-as:
- Ay
Amastan... !
Dɣa
glalzen deg-wakal
- Ay
Amastan! Akken ad neddu deg wawal-ik, aql-aɣ nsumeḥ di tudert-nneɣ.
Atnan ifassen-nneɣ d ilmawen, nsemeḥ i tɣawsiwin i d-yusan ẓẓayit
fella-sen. Allaɣen-nneɣ d ilmawen; tifekkiwin-nneɣ uradent si
tawant, ulawen-nneɣ uraden si tayri, igelman-nneɣ uraden seg uslufu!
Aql-aɣ akken i d ay triḍ nbeddel ticlemt, d ilmawen, d izedganen!
Di
tazwara, Amastan iɣli-d fell-as uɣemɣam, yerwi wallaɣ-is.
Am yergazen am tulawin n Héliopolis qqlen d imerriɣen. Ayen i
d-asen-yeqqar yettawi-ten s asif. Fsin snasel-nsen, maca uɣen-d snasel i
tent-yugaren. Inna-yasen : tebram.
- Ay
imdanen! i kra yellan; maca ɣurwet ad tebrum i lfeḥ.
- Dacu-t
lfeḥ-agi? I d as-d-rran yemdanen.
- Lferḥ
i d awen-d-nniɣ! Acku ala i Iferḥ iwumi i d-tlulem.
Dagi
isekcem-d iman-is Wuḥric, yiwen seg yinelmaden Umastan; inna:
- Ay
Amastan! S tafat wallaɣ-ik i nteddu, sḍil-aɣ-tt-id kra ad
walint wallen-nneɣ tiderɣalin. Nekni i iteddun di tillas, nɣil
ulac lferḥ mebla tikli, mebla amhetwi, mebla tayri, mebla agani. ɣef
wanect-a i d-yusa umeslay-ik ad aɣ-iseḥlu seg-sen. U1-nneɣ d
amuḍin, imi ilaq ad yefren gar lferḥ d lehna.
Segmi
yesla i yinelmad-is, yeẓra Umastan d akken aɣref n Héliopolis yeqqim
kan di tidak-is, werɛad imsebḍa netta d tkerkas tiqdimin. Dɣa
yewwet ad yawi abrid d tid-is; yenna-yasen:
- Tiɣawsiwin
akk tesɛam, neɣ tiɣawsiwin i kun-yesɛan, snimt-tent d
agernmun.
Rran-as-d
yelmeẓyen:
- Ad
atent-nesni, syin ad atent-nesreɣ!
Inna-yasen:
- Ala!
Beddet ɣur-sent! Akka yal yiwen deg-wen ad yuɣal ɣur-s agerruj s
tɣawsiwin n wiyaḍ.
Neṭqen-d
yimzenza:
- S tidet;
yyaw ad nesni tiɣawsiwin d agemmun syin ad atent-neɛbed.
Nniqal,
ikker Umastan ad isufeɣ imzenza si lemqam, yuɣal immekti d aẓar
yellan gar usirem d wayen yettnuzen. Ma yenɣa ayen yettnuzen, yenɣa
asirem d umenni deg wulawen n yemdanen.
Yenna-yasen:
- Ay
imdanen! Ur xelleḍet ara Caɛban d Remdan; tiɣawsiwin-agi ad
atent-tesnim d agemmun ad ggtent! Tewwi-d ad atent-tesxedmem kunwi,
mačči d nutenti ara kun-yesxedmen! Ulac meyya iberdau: ad
atent-tesxedmem neɣ ad tuɣalem d aklan-nsent.
Imdanen
wwten afus. Yeffeɣ-d yiwen unaẓur; imekken idukal-is i Wmastan,
yenna:
- Nebɣa
ad atent-nesexdem, acku ad aɣ-sxedment tɣawsiwin mebla tara neɣ
Amastan, yiwen-is!
Tekker-d
yiwet tlemẓit yettumelken seg yirebbiten.
D aḍu,
d igefran, d asigna akk d tmes i s-d-yettawin ameslay-nsen. Tenna s tmeslayt n
Hélioliolis taqurant, i fehhmen ala at tfenṭazit :
-
Kečč d agessas! D kečč i iseḥluyen! Kečč d
Amastan werjin necciḍ! Tuɣeḍ-tt-id sɣur Rebbi!
Ṭṭef
taɛekkazt udabu (leḥkem) medden akk ad ddun deg wawal-ik! Anda-tt
tmusni-k akk d ilugan-ik? Anda d-tenniḍ ddut ad neddu! Anda tersiḍ
tagust-ik, ad nessiɣ times-nneɣ! I-d yenna yimi-k ad tgen ifassen-nneɣ!
Ad neddu yid-k am tili-k. Ass m'ad d-tass tmettant ad ak-tawi, ad ak-id-nekkes
deg yifassen-is!
Yenna-yas
Umastan:
- A tameṭṭut!
Tesxesreḍ ameslay, yerna aql-ikem d tamerrit! Mačči d nek ad
d-tesfehmed! Sefhem allaɣ-im! Maca nek surfeɣ-am imi ayen i d-tennid
d azedgan!
Tefsi tmeṭṭut-nni
amzur-is, teglalez deg wakal zdat iḍarren Umastan; tenna-yas:
- Anef-iyi
ad sefḍeɣ tawrent yulin iḍarren-ik s wemzur-iw!
Yekkes
Umastan irkasen-is, yerfed-d tameṭṭut yebdan tseffeḍ
idarren-is; akka ur d as-qqaren ara yuɣal d Rebbi, syin yenna:
- Ulac taɣawsa
yifen tayerza n lferḥ, akken ad at-megren wiyaḍ akk d win i
tt-ikerzen.
Yenṭeq-d
Wuḥric i tikkelt niden yenna deg wawal-is:
- Lferḥ
i nekkni ahat! Xas ma yella ur nuɣ ara yid-s tannumi, nezmer kan ad naɛreḍ
ma nemger-it. Ma yella i wiyaḍ werjin neɣri amek ad asent-id-nessis?
Dimi i ylaq ad d-nesnulfu ilugan i yess ara ddun!
Yerna-d
yiwen umusnaw awal-a:
- Ilugan
iquranen akken ad yeddu d ubrid yelhan uɣref ur nezmir i yiman-is. Akka i
t-id-teǧǧa tmurt; ayen i iḥemmel umdan d amenzu: d iman-is.
Amastan
inguga wul-is acku imdanen n Héliopolis ugin ad gezmen snasel i gezmen ula .d
idammen-nsen.
Inuda amek
ara ten-yesɣer; yufa tewwi-d ad isemres iqwan; acku imdanen-agi am arrac:
ilaq ad aten-izuzen s tmucuha mačči s tidett iqerḥen. Imiren
yenna-yas kra: Amek ara tesseɣreḍ imdanen s tmucuha, imi nutni d
tiden i ten ineqqen!
Amastan
yenguga ugar; ad inesraɛ neɣ ad d-isefsi ayen i d-yenna? Yuɣal
yenna:
- Llant
snat taggayin n tmucuha: tiden i ttawin ɣer tmenjert akk d tiden iseḥluyen;
tiden isidiren akk d tiden ineqqen.
Iwala
Umastan d akken yebda taɣuri. Zdat tegnitt-is; yeqreḥ-it wul-is.
Yenna i yiman-is:
- D abrid
aweɛran i wwiɣ. Yezmer ad aɣ-isufeɣ ɣer tmenjert! Acku
asm' ara kecmen yemdanen di tirga, yezmer ad yegzem wallay-nsen, ad yeqqqim
deg-sent, nutni ad d-uɣalen ɣer tidet.
Isusem kra
yuɣal yenna:
- Akken ad
kecmen ɣer tegnitt tatrart ahat tewwi-d ayagi. Tewwi-d kan ad ferneɣ
timucuha.
Seg imiren
netta yettnadi di tedmi-s anti timucuha i
yesferḥen temẓi-s. Ur yufa ara. D tiden i isefraḥen i
yettawin ɣer tmenjert. Ma yewwi-tent-id i ymezdaɣ n Héliopolis ad ɣlin
din-din, ad teḍru yid-sen am widen werjin neddir.
Yeffeɣ
uberreḥ i uɣref ad inejmaɛ azekka-nni.
Yusa-d uɣref
di tafrara, acku yenna-yas Umastan d tikkelt taneggarut ara t-id-imeslay.
D yiwen
umehzul i d-yewwden d aneggaru ɣer tejmaɛt.
Dɣa
yebda Umastan ameslay; yenna deg-s:
- Ay
atmaten-iw! Ass-agi ad akun-ǧǧeɣ...
Segmi i
ywa1a ur t-fhimen ara yerna-d:
- Ad akun
ǧǧeɣ i lebda...
Imiren,
bdant tulawin imeṭṭi; tilmeẓyin gezrent tiḥnikin-nsent
s waccaren.
Yesked
Umastan ɣer widen ur nebwawel ara, yenna-yasen:
- Kunwi s
widen ur nettru, teṭfem di tidett. Imi id iyi-d-ggran kra wwussan
garawen.
Yegzem-as-d
yiwen ameslay, yenna:
- Acḥal-aya
i d-tettadreḍ tidett, maca werjin i d-tennid d acu-tt?
Niqal
yekker ad asen-yini-Umastan: mačči d tifin i yesgan azal maca d anadi
acku ass m'ara yawḍen
ɣer
tidett ad ɣlin mebla tanekkra.
Yuyal
yugad ad asen-yegzem asirem s tesraft i la d-asen-yeqqaz. Yufa-d yiwen ubrid
afessas, yenna yasen:
- A widen
ur nessin amekti! Nniɣ-awen d dacu i d abrid isufuɣen: d tideg; d
lferḥ! Fket-asen i yemdanen lferḥ, syin ssed-iten wa ɣer wa
alamma yekka gar-asen ayen yekkan gar yiccer d uksum!
Yeɣra
di tmuɣli-nsen d akken aṭas ur nefhim ara timenna-s. Maca imi d
tikkelt taneggarut i ten-id-imeslay, yugad Rebbi deg-sen. Yewwet ad asen-d-yini
tidett segmi ifuk azuzen d tmucuha.
Yenna-yasen:
- Anda-ten
at ccraɛ-nwen?
Llan akk
din, acku ass-agi aneggaru yeslal-d ɣur-sen asirem akk d tugdin. Qqimen
deg yiwet teɣmert, ttergigin am yiwen, ttwalin d ayen iḍerrun, iḍarren
heyyan i trewla!
Aṭas-aya
ideg i sen-yettwakkes leḥkem. Teḍra yid-sen am widen yewwi wasif,
yeṭfen deg yilili; maca urɛad ten-yečči wasif.
Usan-d at
ccraɛ, nutni ttergigin, s tɛumam d tqendyar timellalin.Tikli-nsen d
tin iḥuqal, ma d iseɣ sanda yeqqim.
Yenna-yasen
Umastan:
- Awit-d
idlisen ilugan-nwen.
Suffɣen-d
di tsenduqt iruccen s wureɣ tiḥedrin weglim n tzerzert anda yura s
tnelwa n wureɣ imassan imeqranen n Héliopblis ilugan-nsen. Syin isawel-d
Umastan i yiselmaden yesɣaren ddin.
Ddan-d
akk, wa yebra i wallen-is, wa yerfed aqerru-s s igenni.
Yengeq-d
Umastan yenna:
- Anda
llan widen i d awen-d-yemmalen iberdan n tmeddurt?
Usan d kra
ur iban d acu ten; kra d wid yelhan, kra d ungifen, kra d wid yumnen!
Yezzi
Umastan ɣer uɣref yenna-yasen:
- Ihi?
Wehmen
imdanen; ur fhimen tigert!
Ikemmel
timenna-s:
- Nutni di
cwiṭ, kwenwi d aqejḍil!
Iger-d
iman-is Wuhric:
- Ay
Amastan! Tewwi-d ad ak nessefhem d akken mačči d taluft wemḍan!
Acku aqejḍil-nneɣ ittemrurud deg waka1! Akal yezderɣel-aɣ
allen! Ufrinen ttmeslayen d irebbiten! Lḥnin-d ay Amastan! Imi d ass
aneggaru ara teqqimeḍ yid-neɣ (dɣa ɣlint kra n tlawin
xcawtent). Iḥnin-d! Sfehmaɣ-d taluft meskud mazal tafat!
Yenṭeq-d
Umastan:
- Ma tebɣam
ad teḥlum...
Yenṭeq
uɣref: -
- Nebɣa
ad neḥlu!
Taɣect
n uɣref tusa-d am tayugt tameqrant deg yillel. Ikemmel Umastan yenna:
- Ma tebɣam
ad issinem lferḥ...
Yenna uɣref:
- Nebɣa
ad nissin lferḥ.
Yerra-yasen-d
Umastan:
- Ihi...
Akka i
ttergigin, ttrajun awal ara ten-id-yekksen si tawla n timmuɣbent. Yesken-asen-d
Umastan taggayt-nni n yimḍebbren n uɣref, syin am akken yettmeslay-d
akin-akin, yenna:
-
Kkset-tten seg-wen! Syin...
Yesken-asen-d
adlis-a yilugan n ccraɛ; yenna:
- Serɣet-tten!
Imi i
d-yenna aya, ur yeẓri Umastan ma t-refden neɣ ad ččen
aqerru-s. Yemdel allen-is, yegguni ma ad
ṭreḍqen
d urfan neɣ d lferḥ. Imi i d-yelli allen-is yufa-d ula d yiwen ur d
as-yesmuzgut!
Retour en haut
Numéro 74
Février 2015
L étude :
AMESLAY ƔEF TJEGDIT
D dadda-t-neɣ, d
ameddakel-nneɣ, d awusnaw-nneɣ, d tijegdit-nneɣ. Tameddurt-is d tira-s, nezmer ad d-nini tezzint ɣef
4 imecwaren:
amecwar amenzu :_seg-wasmi i d-ilul armi d asmi yunag ɣer
Lmerruk
amecwar
wis-sin :_ṭtrad n wemdal wis-2
amecwar
wis-qrad :_ṭtrad n uzarag n lZayer
amecwar
wis-ukkez:_lZayer timziregt.
amecwar
wis-semmus:_ Seg 80 ar taggara
AMECWAR
1u: Ticawrert-is.
Ass n
28 Tuber 1917 deg Tewrirt-Mimun deg At-Yanni, yerna weqcic ɣer Wat-Mɛammer
semman-as: Lmulud. Baba-s yella d lamin n taddart, d amedyaz, i d-yeqqaren
isefra ur itbeddad tisaɛtin. D amusnaw. Yenna ɣef baba-s:
"_Baba, d tamusni ma tella d argaz"!
Asmi
imed cwit, tizzyiwin-is wwdent d imeksawen,
neţţa yunag ɣer lMerruk anida yella ³ammi-s. Yebda
taɣuri-ines talemmast di Rabat, 4 iseggasen d aɣrib, neţţa
mazal-t d aleqqaq.
Yenna:
"- Tamsalt i yi-ddzen d
tamenzuyt, d anekcum kecmeɣ ɣer lycée n Rabat, d asegriwel s
tideţ".
Deg useggas 1934, yuɣal-ed ɣer
lZayer, di lycée Bugeaud ifukk taɣuri-ines talemmast. S-yin ikemmel taɣuri
tameqqrant di Paris, deg lycée Louis-Le-Grand yebges ad iheggi amzizzwer
unekcum ɣer l'E.N.S. i wakken ad yeffeɣ d aprofesseur n lycée. Imir i
yekker ṭtrad wis-2 n wemdal, dɣa tefsax tɣuri i waṭas
iseggasen.
Deg 1938-39, yura tazrawt ɣef "timetti n
Imaziɣen", teffeɣ-ed deg-yiwet n tesɣunt di Rabat, Tasɣunt
Agdal.
AMECWAR
wis-2: ṭtrad wis-2 n wemdal.
Taluft tis-2t, d iseggasen n ṭtrad wis-2 n
wemdal. Yelsa deg 1939, serrḥen-as-ed deg 1940, asmi igan n Fransa
yezda-ten Walman. Yura iman-is di tesdawit n Lzayer.
Ussan-nni iwet ad d-yesuffeɣ deg Wat-yanni yiwet
n tdukkli ɣef yedles amaziɣ.
Asmi i d-yeckem Marikan, luɛan-as-ed abrid wis-2,
yeţţekki di tmenɣiwt yeḍran n ṭelyan d Walman. Ifeddex s waldun.
Ɣef
tallit-a yenna: "_ Aṭas d argaz i ssneɣ, aṭas d ccetla, aṭas
d agdud. Lliɣ yid-sen tameddurt n yal ass, yid-sen i ɣziz
tamussni d tigzi".
Mi
ifukk ṭtrad n wemḍal, yufa-d iman-is di Paris, yebges ɣer
wemzizzwer ad d-yeffeɣ d aprofesseur n "idelsan iqburen"
(lettres classiques). Yuɣal-ed ɣer Tmurt deg 1947.
Yuɣ amḍiq di lycée n Lemdiyya. S-yin yuɣal-ed ɣer Ben-ɛaknun. Iseggasen-a
n ṭtrad d yinig, Lmulud At-Mɛemmer yeccuref ama di tmussni, ama di
tira. Abrid yuɣ ussan-nni deg-s ar-a yeddu alamma d asmi ar-a yemmet:
tasekla, almud, anadi, tamaziɣt.
Abrid-a
zik-zik i t-yenǧer !
1950:
yura yiwet n tezrawt ɣef "Temhazt n tmedyazt n leQbayel", teffeɣ-ed
di La Revue Africaine.
1952:
yesuffeɣ-ed "TAWRIRT NeţţU" d ungal ɣer PLON, di
Paris 1953: d yiwet n tullizt n 11 isebtaren isemma-yas:" Ameur n Leqwas d
Usemsawi (Ameur des arcades et l'ordre).
AMECWAR
wis-3: ṭtrad uzarug-nneɣ.
Lmulud yella di Lzayer, yexdem ɣef Tegrawla. Si Buɛekkaz i s-qqaren, d isem-is n ṭtrad.
Asmi yekker umerẓi ameqqran di Lzayer, Si Buɛekkaz yeffeɣ ɣer
Lmerruk: limer yeqqim di Lzayer, yili aqerru-yis yufeg !
Seg
1957 ar 1962, yeqqim di Lmerruk d acu ur yegzim ara d
tmurt d ṭtrad.
1957:
yesuffeɣ-ed ungal-is wis-2: "Ides usaɛdi" yerna-d yiwet n
tullizt di tesɣunt Preuves (Nû 76) isemma-yas:"Ahdum" (le zbre)
Yegga-d
awal-a ɣef ṭtrad-nneɣ:"- ṭtrad aselluli n Lzayer ɣur-i
am webrid yesuffuɣen, yessawaḍen ɣer yeswi kra ma walaɣ-t,
d neţţa i d yerran agdud ɣer tudert."
AMECWAR
wis-4: Lzayer deg uzarug. Dda Lmulud.
Deg tezwara n timmunent yewwed-ed Lzayer. Azarug yesḍmaɛ-it aṭas, yesget
fell-as asirem. Tura aţţan tewwed-ed tegniţ yurga wi cfan-aya, gezmen leqyud ad tekkes tekmamt, tilelli tura
tewweḍ-ed nnuba-s, amdan ad ţ-yidir, neţţa aṭas yaɛlef
tuggdi d uzaglu. Ad tekkes tbarda yerran amdan d war-tugna, aṭas
i nehhren deg-s wiyaḍ. D tamaɣra usirem, d
tin n tlelli, neţţa yedder armi i t-iwala. Cwit kan kra din yexreb, kra din yefsex: ziɣ taluft yeffɣen
d tayeḍ ar-a d-nagem.
Yaɛna
imḍebbren n Tɣuri, iwet amek ar-a yesekcem taɣuri n Tmaziɣt
di Tmurt-is, ulac win i s-yeldin tawwurt. Gezmen-as ifadden, yuɣal ɣer
unadi-ussni i iman-is. D tira:
Deg 1965, yesuffeɣ-ed "Afyun d Uɛekkaz".
"Zqem
neɣ qezzeb, skiddeb neɣ debbez, seg-wasmi tebda ddunnit
ulac abadu yeffɣen i wefyun neɣ aɛekkaz"
(p.14)
Tamsalt
n tmaziɣt yeddem-iţ, i-mi ggumman ad s-ed-rren awal: yerra-ţ d
taluft-is netta. Seg 1965 d asawen, kra n yelmeẓyen
frurin-d ɣef yedles d tmeslay-nnsen, nudan ad ten-ɣren. Mɛammeri yebda yesɣar-iten ttesrih ulac armi d aseggas
74. Iseggasen-nni yessuffeɣ-ed "Tajerrumt n Tmaziɣt",
tura s tmacint kan. D tin ar-a
d-yizrigen ɣer Maspéro deg 1976.
Deg
1967, yura yiwet n tceqquft unezgum isemma-yas "Acili"
(le Foehn) . Turar-it terbeɛt
n T.N.A. di Lzayer.
1967 daɣen, neţţa d JM Cortade, suffɣen-ed
"Amawal tafransist- Tamaceɣt".
1969: Yesuffeɣ-ed
"Isefra n Si-Muhend" ɣer Maspéro, di Paris.
Iseggasen-a
d afella yella d amassay n le CRAPE di Lzayer. Sin iberdan i ddurt
yessemlalay-ed inelmaden-is, ţnadin ɣef umawal amaziɣ. Knan ɣef
"Umawal n Tmaziɣt tatrart" i d-yeffɣen deg 1980, ɣer
Imedyazen, di Paris, d "Umawal n Teqbaylit" nnig 25000 imeslayen ar
ass-a ur-ɛad i d-yeffiɣ.
D neţţa i d amassay n tesɣunt Libyca aṭas
iseggasen.
Aṭas deg wid yessɣer, d nutni i yeddmen
tamsalt n Tmaziɣt ger 1969 d 1980, ama di Radyu, ama deg unezgum, ama deg
tira n Tmaziɣt (Aterǧem, tamedyazt, ungalen) neɣ deg tigawt
tasertit.
1973:
Yesuffeɣ-ed "Adraw" (Le Banquet) yedda yid-es "Amek negren
Yaztiken" ɣer Perrin, di Paris.
1976:
Yesuffeɣ-ed "Tajerrumt n tmaziɣt" ɣer Maspéro, di
Paris.
1980:
Yesuffeɣ-ed "Isefra iqburen n Leqbayel" ɣer Maspéro., yerna-d "Macahu" d
"Tellem-cahu" d imudden n tmucuha, ɣer Bordas.
Aseggas-nni,
"am win yesmendagen i yeɣlal
"mi tewweḍ tfidi s iɣes".
D
neţţa i "d taqeccurt-nni s yendeh deg igenni,
"deg
tasa d wulawen
"uḥajij anwa ar-a t-id iqarɛen.
Terɛad
tebreq, yuɣal usirem yemdel abrid-nniḍen.
Di
taggara n tmeddurt, mi medden sggunguyen , mi medlent
yak tewwura, neţţa yebda amecwar-is aneggaru.
AMECWAR
wis-5: Seg 80 d asawen. Tasɣunt "Awal".
Asmi
yeffeɣ lantrit, imir Dda Lmulud At-Mɛammer ɣas agerbuz yekna,
aqerru icab, maca allaɣ-is mazal-t d ilemzi. Tura yewweḍ-ed
lawan ad yesuffeɣ yiwet deg tirga n temzi-s, asmi deg At-Yanni deg
iseggasen 40, iwet ad d-yexleq tadukkli ɣef yedles amaziɣ.
Tlul-ed yiwet n tesɣunt isemma-yas "Awal" d tdukkli
"CERAM" (Axxam n tezrawt d unadi ɣef tmaziɣt), lulent-ed di
Paris: da ɣur-neɣdi tmurt uɣalent tmedlin ɣef tikta .
Tura
si 80 d asawen, idlisen, yal aseggas s yiwen, yufa iman-is, ukud i s-ye©©a
welmud tura atan d ayla-ines: Dda Lmulud At- Mɛammer,
tura yewwi tilelli n tideţ.
1980:
isefra iqburen...
1982:
Yesuffeɣ-ed Taceqquft-is "Acili" ɣer Publisud,
1982:
yerna-d ungal-is wis-4 ɣer Plon: "Tazggert"
1984:
d Ahellil
di tgurarin ɣer MSH, di Paris.
1985:
d uṭtun 1 n tesɣunt awal
1986:
d uttun 2 n tesɣunt Awal
Neţţa
daɣen d bab n isurag. Kra n wanida yella weswir
neɣ temlilit tussnit anida yezmer ad d-yini, Dda Lmulud atan din. Yefka-ad tayeţ akken ilaq i tesɣunt Tafsut.
Atas n tezwarin i yura, i yemyura imaynuten am Saɛid
Saɛdi Racid ³allic d wid-nniden
Ass-nni,
d ass amcum asmi i d-yuɣal si Lmerruk, deg Taggara n Furar: aḍu, iḍ,
temɣer, asekkud ixussen mjajin-as, d wayen yuran !
Nezmer ad d-nini Tamurt n Lmerruk am wakken d
tamurt-is tis-2t, tuɣ amekkan ameqqran deg wul-is: din i yeɣra, din i
i d-yeldi allen-is i yedles, din i yeqqim asmi tehres tegniţ fell-as, di
taggara amzun s-syin i d-yemmut !
Ass n
26 di Furar 1989, yemmut usaɛdi. Teḍra yid-neɣ am
"_
Lexwan yellan d imexlal
ɣas
ţrun yuklal
anwa ara-ten-id iweṣsin"
Llan
yergazen ur neţmeţţat, ţɣaben
maca zgan gar-aneɣ. Dɣa deg useggas-nni deg uɣalent fell-as
tmedlin, yeffeɣ-ed wedlis-is aneggaru, d awdiɛ. neţţa
yebda-t s tira deg 1939. 50 iseggasen , azgen n lqern,
neţţa yegguni-t: "Ccix Muhend yenna".
"Imezwura
iban-asen
ineggura iban-asen
aḥlil ay ilemmasen"
Yewɛar
umeslay ɣef-tjegda !
Ma yella kra ixussen deg
umagrad-a, neǧǧa-t i wid i ɣ-yifen.
S.IGHILFALU
TILIWA:
_ Jean
Desjeux: Littérature Maghrébine de Langue Française
Ed. Naaman, Québec, 1980
_ Classiques du Monde, Mouloud
Mammeri
SNED-Natahan, 1982
_ Dictionnaire des littérature de
langue française BORDAS
_ Ayen
yura Lmulud At-Mɛammer.
Retour en haut
Numéro 74
Février 2015
L évocation :
...Iteddu
akken yufa Maççi akken yebgha
Par A.OUFREHAT, EL_WATAN
27/03/1995
Même
si nous n'avons pas pu retrouver la trace écrite de ces 2 vers, ils sont
authentifiés par ceux qui ont eu la chance d'avoir approché Mouloud MAMMERI de
son vivant, ses élèves ou ses collaborateurs. Ces 2 vers sont devenus un lieu
commun dans les milieux de la militance culturelle berbère. Mais combien de
personnes ont analysé leur sens ? Qui a posé cette question fort simple:
"_Qu'a voulu dire l'auteur ?"
Au-delà de la beauté de la rime, il convient de s'interroger sur le message
véhiculé, car c'est le génie des grands
poètes que de savoir dire des choses
compliquées avec des mots simples.
...iteddu
akken yufa
Maççi
akken yebgha:
Quoique
traduire, c'est trahir, le sens de ces 2
vers est le suivant:
Celui
qui, le premier traverse une neige vierge, ne peut marcher selon ses désirs,
mais seulement de la façon que le lui
permettent les contraintes de cette neige."
L'action
du poète et son engagement dans la vie miliante, voire la vie tout court, se
réaliseront en fonction de l'espace environnemental. L'idéal du poète est
tributaire des contraintes vécues, il accepte délibérément que l'amère réalité
puisse être un frein, un poids à la
volonté.
Le rêve et l'idéal sont volontairement domptés et ne subjuguent en aucun cas le
poète qui reste conscient que la trajectoire à suivre ne saurait être déviée,
quoiqu'un retard tactique soit consciemment assumé.
Le souci d'éfficacité et la conviction dans la
justesse de l'idée compensent largement les frustrations occasionnées par les
contraintes environnementales.
Il
y lieu de rappeler que pour faire aboutir des idées il n'existe que 2 voies
au-demeurant contradictoires: la voie rapide et la voie lente.
La voie rapide est la voie dite
révolutionnaire, où la volonté subjugue la réalité sociale, forçant l'histoire:
inéluctable, la violence est toujours présente.
La voie lente est la voie progressive, celle
des petits-pas, non-révolutionnaire, pacifique. On l'appelle également
réformiste.
La première voie fait confiance d'abord à la
force, la 2ème voie d'abord à l'intelligence.
Les
écrits et la vie de Mouloud MAMMERI montrent
une méfiance obstinée vis-à-vis de la première voie. La 2ème voie est
celle qui a guidé sa vie et ses engagements.
Pour
faire aboutir ses idées_et Dieu sait que ce grand homme en était un grand
réservoir_ ce "démocrate impénitent" choisit "de donner du temps
au temps", de laisser mûrir la cause pour la faire aboutir avec un minimum
de déchirements, loin des discours et des prises de position extrêmes. Mouloud
MAMMERI n'était pas un révolutionnaire, au sens commun du terme.
Il
était trop sage et trop intelligent pour ignorer que les révolutions conduisent
à des déchirements, des impasses et des dictatures. Il a toujours su mettre une dose de sagesse
dans ce monde aux multiples logiques.
Actuellement
beaucoup de monde se réclame de sa pensée, tout en la trahissant, par ignorance
souvent, par manipulation politique de temps en temps.
6 années après sa disparition, il est
impératif de faire prendre conscience à tous ceux qui se réclament de lui tout
en piétinant sa philosophie, qu'ils font du tort à la mémoire du maître. Et
par-là même, ils se font du tort à eux-mêmes et font du tort aux idées qu'ils
sont censés défendre. Parfois inconsciemment, comme nous l'avons signalé plus
haut. Parfois par ruse politique ou activiste.
En
dénaturant les idées du maître, en les transformant, lls amènent de l'eau au
moulin de la confusion politique et sociale ambiantes. Alors que
l'intelligence, sous peine de s'auto-détruire doit militer pour la clarté.
La
ruse politique entrainant toujours un effet paradoxal, ils ferment la porte du ghetto alors que la finalité
première était de l'ouvrir.
A
la lumière de ce qui se passe, de ce qui se dit ou se fait, dans les milieux se disant légataires de la
pensée du maître, il apparaît entre autres, que les 2 vers sus-cités ont été
vidés de leur substance.
A
défaut d'avoir été finement discutés et anlaysés, ils ont été galvaudés puis
pervertis, pour devenir un slogan où la
rime a pris le dessus sur le message à transmettre.
Et quand on délaisse l'analyse pour le slogan,
cela s'appelle populisme.
J'invite, en tant qu'ancien élève du poète, à
analyser les 2 vers sus-cités (...Akken yufa / Maççi akken yebgha) puis je les
invite également à discuter cette autre
phrase, lancée à la face de "ceux
qui prônent le plus véhémentement un retour aux sources" que le non-moins
regretté Tahar Djaout a receuilli de la
bouche du vieux sage:
"_ Il en va d'eux, un peu comme ces
voyageurs enagagés par distraction dans les vases du chott: plus ils font
d'efforts pour se dégager et plus ils s'enlisent."
En
guise de conclusion, j'ose cette question: Si Mouloud MAMMERI était encore de
ce monde, aurait-il soutenu le boycott
illimité d'une école algérienne bien que véreuse, anachronique et
criminogène ?
Dda-Lmulud,
en ce douloureux anniversaire de ta disparition, là où tu es pardonne-moi
d'avoir cité ton nom, dans cette anomie
du monde des vivants, car toi et moi nous savons que prononcer le nom d'un mort
est un acte lourd de signification: "les
morts n'aiment pas qu'on parle d'eux car ils sonr dérangés dans l'au-delà, le
repos éternel s'en trouve irrémédiablemnt perturbé".
Mais
pour moi et ceux qui me ressemblent, tu n'es pas mort, tu as seulement cessé de
vivre ! Tahar,aussi !
Et, pour le temps qui nous reste en ce
bas-monde, oui, "An-neddu akken
nufa Maççi akken negha."
A.OUFREHAT
22/02/95
EL_WATAN
27/03/95
Retour en haut
Numéro 74 Février 2015
Portraits :
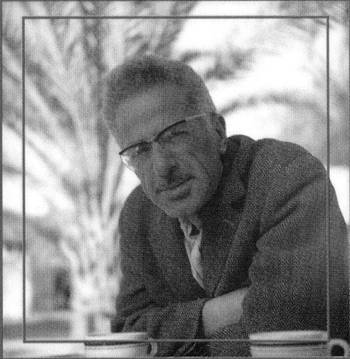

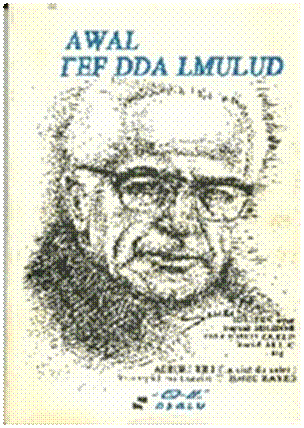

Retour en haut
Numéro 74 Février 2015
Une
autre interview :
Le rôle du romancier...
interview de Mouloud Mammeri réalisée en février 1984 et publiée dans
"The Middle East magazine" par Chris Kutschera.
http://www.chris-kutschera.com
Q : Votre dernier livre, l'Opium et le
Bâton, date de 1965, sauf erreur. La "Traversée", de l'année
dernière. Ce qui fait dix-sept ans de silence. Pourquoi ce long, long
silence ?
Mouloud Mammeri : ... Je pense personnellement que c'est, en grande
partie, dû à l'histoire, non seulement la mienne, personnelle, mais l'histoire
algérienne, parce que comme mes romans épousent la réalité algérienne, en gros
en tout cas, et l'épousent comme ça dans le temps, j'avoue que pendant cette
période... Cette période a été tellement traumatisante, tellement essentielle,
qu'à mon avis il n'y avait que deux façons de la traiter ou de s'en
servir :
Ou bien comme un chroniqueur, le travail d'un journaliste
qui raconte au jour le jour les évènements tels qu'ils se passent, et qui éventuellement
les interprète, ce qui n'est pas du tout mon rôle, ni ma compétence...
Deuxièmement, justement, peut-être, celle que j'ai
choisie, la voie que j'ai choisie, le roman, mais alors là, c'est tout à fait
différent ; à mon avis vous n'êtes pas du tout assujetti à
l'actualité ; mais surtout je crois que le point de vue du romancier est
différent de celui du chroniqueur parce qu'il lui faut à lui une certaine
distance par rapport à l'évènement, il lui faut une certaine distance, il ne
peut pas coller à l'évènement, exactement.
À mon avis les faits tels qu'ils se déroulent, en tout
cas pour moi, je ne sais pas si c'est comme ça pour les autres, mais c'est
comme ça que ça se passe pour moi, à mon avis les évènements ont besoin d'une
espèce de décantation, d'une espèce d'intériorisation, à l'intérieur de
moi-même, pour qu'ils prennent une autre valeur, une autre dimension, qui
puisse devenir réellement romanesque.
Je crois que le roman, si vous voulez, en mentant,
puisqu'on invente une histoire qui n'existe pas, qui n'est pas vraie, en
mentant, à mon avis, va au fond d'un certain nombre de choses, va un peu plus
vers l'essentiel, puisqu'on invente.
Un romancier est obligé d'inventer ; c'est son
métier, d'accord, mais il invente toujours dans le sens d'une vérité à mon sens
plus profonde.
Enfin on ne peut pas mentir n'importe comment.
Alors, à cela s'ajoute que sur le plan personnel, bien
sûr, la simple adaptation de l'ancien mode de vie de l'Algérien moyen comme moi
à l'indépendance, avec tout ce que cela suppose... avec les évènements qui se
sont passés dans l'intervalle... suppose quand même une certaine... suppose
qu'on est accaparé au jour le jour, et là vraiment je n'ai pas eu le
temps : il a fallu que je me réadapte à un mode d'existence différent,
nouveau, oui, alors je pense que c'est comme cela que cela s'explique.
Je m'excuse, c'est une simple parenthèse, mais pendant
ces 17 ans, je n'ai pas fait paraître de roman, mais j'ai écrit quand même des
choses qui ne sont pas encore parues, que j'ai gardées
en manuscrit... et j'ai publié des études sur la poésie berbère.
Q : Si l'on en juge d'après la lecture de
la "Traversée", vous ne semblez pas très heureux, très épanoui,
dix-sept ans après l'indépendance. Ce livre est assez amer. Est-ce que vous revendiquez
cette amertume ?
M.M : oui, je la revendique entièrement.
Bon, maintenant encore faut-il en donner les raisons.
Je pense que le travail, la fonction, la vocation, je
n'aime pas trop ces mots-là, enfin bon, disons simplement l'uvre d'un romancier
ne peut pas être vraie si elle n'est pas, qu'elle le veuille ou pas,
contestataire de tout ce qui nie l'Homme.
Mes points de référence n'étant pas politiques, il est
normal, à mon avis en tout cas, qu'un romancier défende les valeurs les plus
hautes, même si elles ne sont pas immédiatement réalisables.
Peut-être que l'homme politique est obligé de tenir
compte de je ne sais pas quoi, de la réalité de l'environnement économique,
humain, sociologique ; mais moi je ne suis pas un homme politique.
Et en tant que romancier, ce qui m'intéresse surtout,
c'est le destin de l'homme, sa liberté, sa pleine expansion ; et dès que
cette liberté n'est pas acquise, dès que cette plénitude n'est pas acquise,
j'ai la conviction qu'il manque quelque chose, et que mon rôle c'est justement
de crier que quelque chose manque à cette plénitude.
Sans cela, qui remplirait cette fonction ?
Cela peut être celle d'un intellectuel, d'une façon
générale, je suis d'accord, mais je trouve que le roman est un excellent moyen
pour cela.
En effet, j'assume entièrement cette amertume, comme vous
dites, mais connaissez-vous cette formule : "Que la République était
belle sous l'Empire"...
C'est toujours comme ça.
Les gens qui ont fait cette révolution, qui y ont
participé, avaient naturellement des images belles du futur, que les évènements
réels, que la réalité ne peuvent pas confirmer.
C'était presque couru d'avance, si vous voulez.
Mais encore fallait-il que quelqu'un le dise...
Eh mon Dieu comme je n'avais plus rien à attendre, comme
j'avais un certain âge, il a fallu que ce soit moi qui le dise, et voilà...
Q : On peut d'ailleurs se demander s'il y
a eu révolution ?
M.M : Là, le problème est tellement vaste que ça n'est
pas la peine d'entrer dedans.
Donc ceux qui ont fait la guerre de libération, qu'ils le
veuillent ou non, avaient au départ un tempérament qui les prédisposait à
ça ; non seulement il y avait une idéologie, bien sûr, il y avait le fait
qu'ils voulaient un certain ordre, se débarrasser d'un ordre et en instaurer un
autre ; mais en dehors de l'idéologie, une fois que vous entrez dans la
pratique quotidienne de cette guerre de libération, il faut un certain
tempérament...
Et la guerre était longue, à mon avis, trop longue, sept
ans et demi, c'est beaucoup pour une guerre de libération qui a été aussi dure.
On finit au bout d'un temps si long par utiliser beaucoup
de vertu, qualités, qui sont très efficaces pour la lutte, effectivement ;
mais quand la paix revient, vraiment, ça devient des handicaps extraordinaires.
Enfin, celui qui a été héros pendant sept ans est tout à
fait désemparé quand il revient, parce qu'il ne sait que faire de son héroïsme,
il ne sert plus à rien.
Même si la formule vous parait un peu comme ça.... on ne
peut pas dire ça ne sert plus à rien, bien sûr, mais vraiment, il est
désemparé, il ne sait plus comment...
Pour faire vivre un Etat dans sa routine quotidienne,
pour résoudre les petits problèmes, vous n'avez pas besoin de ces mêmes
qualités que pour tenir le maquis pendant je ne sais combien d'années, avec
tout ce que cela implique de courage, physique et mental, c'est tout à fait
différent.
En tout cas ici c'est assez frappant...
Mais je crois que c'est partout comme ça.....
Retour
en haut
Numéro 74 Février
2015
Tidlisin nniḍen :
Enfin un
CLAVIER COMPLET :
http://www.ayamun.com/Tamazight.zip
Yennayer_S.Bouterfa.pdf
Khaled-Ferhouh_Hku-yagh-d-tamacahut.pdf
Belqasem-Ihidjaten_Itij-asemmad.pdf
Afeɛɛes, la question d'Henri Alleg, s teqbaylit en PDF
_ JM DALLET
Dictionnaire Français-Kabyle.pdf
_ JM DALLET
Dictionnaire Kabyle-Français.pdf
dans notre rubrique Téléchargement :
http://www.ayamun.com/telechargement.htm
Retour en haut
Numéro 74
Février 2015
La conférence :
Mouloud MAMMERI, le défricheur de savoirs, par Ali Sayad.
La force de
la parole et la vigueur de la mémoire, Conférence donnée à
El-Flaye le 20 avril 2008
Win iţruẓun asalu
Iteddu akken yufa
Mačči akken yebγa.
(Celui qui ouvre la voie
Va comme il peut
Non comme il veut.)
Lécriture, dit-on, porte la marque tragique
de la ténacité de lhomme de durer en transmettant après
lui la trace de son passage. La pierre et les parois rocheuses, les tablettes dargile et la cire, le tissu végétal arraché à larbre,
le liber, ou les rouleaux de papyrus, la peau et lomoplate
danimaux
en étaient les supports,
en sont les premiers témoins. Cest en Chine, dès le IIe
millénaire avant notre ère que serait apparu le livre.
Les fouilles entreprises dans le petit cimetière copte dal-Mudel en moyenne Egypte, révélaient la sépulture dune fillette de douze
ans, inhumée il y a seize siècles. Pour veiller sur elle, sa famille ensevelit
avec elle un trésor : une Bible Byblos, Le livre de quatre cent pages de parchemin de
format 17 x 13 centimètres, cousues
entre elles en cahier à laide de fils de métal et de
lanières de cuir, et bien protégé par deux planchettes de bois recouvertes de
cuir. Cétait un codex qui deviendra notre livre actuel,
objet de culture par excellence.
Lhomme amazigh, qui signifie en berbère
homme libre, nom que se donnent les anciens habitants de lAfrique du Nord et ceux, parmi eux demeurés encore berbérophones, a été
le premier, ou tout le moins lun des premiers à détenir
un système décriture alphabétique, signalé de son temps
par Hérodote sous le nom de libyque, et désigné aujourdhui
alphabet tifinagh. Les Imazighen (pluriel de Amazigh), à part des inscriptions
magico-religieuses gravées sur des stèles, des amulettes pour se protéger de
tout malheur qui pourrait arriver, ou de courts messages laissés sur des parois
rocheuses pour signaler leur marche dun pâturage à lautre, nont pas éprouvé le besoin de produire une
littérature écrite : ils savent dexpérience le
destin qui frappe les hommes et lavenir réservée aux
livres. Cest Sainte-Beuve qui écrivait :
Le sort des hommes est ceci :
Beaucoup dappelés, peu délus.
Le sort des livres, le voici :
Beaucoup dépelés, peu de lus.
Aux textes littéraires écrits, lAmazigh leur préfère la production dune
littérature orale en prose ou en vers, exprimée dans une langue différente de
celle pratiquée au quotidien. Etymologiquement oracles et orateurs se
rattachent au verbe latin arare, « prononcer une parole
importante », de caractère religieux ou juridique. Des dits des oracles,
quand on résout toutes les énigmes, il est resté en berbère le verbe et le
substantif « urar » et le dérivé « amurar »
(pl. « imuraren »), celui qui négocie le henné (azenzi
n lḥenni) à tous opposant à la
cérémonie du mariage. Dans lexpression « iţţurar
s wawal », il joue avec les mots, lAmazigh fait
la guerre avec les mots pour faire taire les armes, il laisse parler « bab
n wawal » (le maître du dire) et réduire au silence « bab g yiγil » (le détenteur de la force).
« Dans [la cérémonie de] lḥenni, nous dit Mammeri, on joue la guerre pour navoir pas à la faire, on sen purge
rituellement dans les figures dun jeu convenu, on évacue
dans les mots les charges dagressivité...» On sait comment des cités-Etats (igherman, sing.
ighrem) sétaient fédérées en amphictyonies (tawsatin)
autour de pierres saliques
érigées en souvenir des oracles. Cest à cette assemblée
que lon a défini les droits et les devoirs des
belligérants, la fédération (tawsa, sing. de tawsatin) lutta
contre lusage barbare de la réparation par le sang humain
et son remplacement par limmolation dune bête, timecreṭ, et fournit un soutien actif aux
populations dont les mauvaises récoltes ou une sécheresse prolongée ou des
épidémies mettaient lexistence en danger
par le sacrifice propitiatoire de lasfel.
A partir de lḥenni, pris comme postulat,
Mammeri extrapole que si le mythe dénoue le donné dans un système de
correspondances significatives, « la poésie résoudrait dans le verbe
les tensions, les manques ou les blocages » dans la société
segmentaire quest en loccurrence la société kabyle,
« et dont la somme constitue lidéologie du
groupe ».
Mammeri trouve en Youcef-ou-Kaci, poète originaire de
Abizar nAït-Jennad, en Kabylie maritime, poète
déclaré des Aït-Yenni, un interprète à la fois fidèle et génial des valeurs de
la société kabyle, car avec lui, le postulat dans cette circonstance joue
parfaitement quand Youcef dit :
Nek d At Yanni grent tesγar Entre les Aït Yenni et moi les dés son
jetés
Nitn inu nek baneγ nnsen
!
Eux sont à
moi et moi cest clair je suis à eux !...
Youcef, dit Mammeri « est un poète partisan ». Il ne sen cache pas :
Tlata tuddar nni Ces trois villages
Ur yessent εadleγ yiwen Pour
moi nont point dégal
Quand la
cause est partisane, la poésie devient une arme et on lappréhende, et elle peut aussi prendre des tournures
sanglantes. Mais la poésie, par le procédé dune voix,
enseigne le plus souvent des valeurs symboliques, comme si, « contrainte
de défendre au plus près des frontières vite atteintes, [la cité] poursuivait
en profondeur une visée plus ample et tentait déchapper
sur le plan des signes à létouffement que lui imposent
ses structures ».
Nayant pas une connaissance définie de la durée et ne
possédant quune mémoire orale du passé, les sociétés
antiques vivaient avec angoisse dans le présent et exprimaient une
préoccupation permanente dinterpréter les signes pour une
lecture de lavenir. Même quand lagourram inventa lécriture, la parole a été le seul outil
de communication de lhomme amazigh. Cest peut-être là la raison pour laquelle la transmission du système
graphique se faisait par les femmes (jusquà ce jour, ce
sont les femmes qui détiennent lécriture quelles reportent sur leurs enfants). La force de la parole et la vigueur
de la mémoire y assuraient la transmission de la culture.
Au langage articulé alors sajoute le langage gestuel riche dun vocabulaire
étendu et même dune syntaxe propre. Le poète, lorateur ou le conteur, intellectuels de loralité,
privilégient la libre expression licencieuse, faite daudace
et de permissivité, dans une syntaxe particulière et osée, de mots sollicités,
souvent singuliers et au sens ambiguë, même archaïques, et fréquemment
empruntés à dautres langues mais obéissant à ses normes
grammaticales. Lexclusive oralité de cette littérature,
destinée à la transmission, cest-à-dire pour être
écoutée, entendue et retenue, nécessite une véritable architecture de la
narration, des disciplines rythmiques et harmonisées, qui la ponctue et la
scande, des règles de récurrence et concordance des places affectées aux outils
rhétoriques.
Lécrit est destiné au lecteur de lextérieur qui a une vision égocentrique de la culture. Chez les
Amazighs, lidentité nest pas
présentée par la différence à lautre mais par son
identité même. : « Je suis plus moi-même en tant que je suis
identique à moi-même, car qui a peur de perdre son identité, la déjà perdue », dit de lui le poète et
compositeur kabyle Cherif Kheddam. Lorsque lécrivain
amazigh écrit dans une langue étrangère, il reste profondément amazigh et ne
perd pas son identité, il enrichit la culture universelle par son expérience et
sa vision du monde, sa participation à la vérité. Lagronome
Magon a écrit son Encyclopédie agronomique en punique ; le roi Juba
II a rédigé son Libyca histoire du peuple amazigh
en grec ; Apulée, le premier romancier du monde a
composé son Âne dor en
latin ; il en est de même des évêques Tertullien, Cyprien, Donat et
Augustin, ces pères de lEglise chrétienne qui ont
consigné leurs traités théologiques en latin ; Mohammed Ajerroumi (de agourram,
prêtre en tamazight) a codifié la première grammaire arabe
en arabe (aujourdhui encore la grammaire est
désignée el djerroumia en arabe et tajerroumt en
tamazight) ; Ibn Khaldoun, ce sociologue de lhistoire,
a écrit son Discours sur lHistoire universelle en arabe ; Jean El Mouhoub et Marguerite Taos Amrouche, et leur
mère Fadhma Aït Mansour, Mouloud Feraoun, Mouloud Mammeri, Kateb Yacine, Tahar
Djaout, Mohamed Dib, Mohamed Kheiredine, Malek Haddad, Malek Ouary, Marcel
Mouloudji, Mohamed-Chérif Sahli
pour ne citer que les
auteurs décédés, sont des écrivains et poètes dexpression
française.
La littérature dexpression amazighe reste une littérature de lentre-soi,
limitée au domaine de linterconnaissance pour se protéger
du danger extérieur et préserver son indépendance, même si pour cela les
locuteurs amazighs doivent sacrifier les richesses des cités, plaines et
vallées pour se réfugier dans le dénuement des montagnes et laridité du désert. Les sociétés s'assimilent beaucoup plus étroitement
à la nature qui les enveloppe alors que les sociétés alphabétisées sen séparent. Plus les individus se font « lettrés », plus ils
cherchent à se démembrer du milieu où ils vivent.
Différentes régions du monde sont concernées aujourdhui par la mondialisation et léconomie
de marché et tout le processus socio-culturel précipité. Cette évolution vers
un marché mondial participe, par lexistence de moyens de
communication modernes, à la circulation des personnes, des technologies et des
biens de consommations. Des petites bourgades, qui autrefois abritaient un
noyau administratif, sérigent maintenant en capitales
régionales, dotées dinfrastructures et déquipement récents, et attirent dans le sillage des idées, des
comportements et des pratiques extérieures aux
usages des sociétés en transition.
Dans ces groupes en mutation, ce sont les populations jeunes
qui reçoivent de plein fouet ces conséquences qui accroissent laction de déculturation et de perte identitaire menée par lécole contre la culture naturelle du groupe social. Ces incidences
s'augmentent de labsence de création demploi qui favorise un exode massif des populations locales. Il se
traduit par une rurbanisation des grands centres. Cette migration frappe les
hommes et les femmes, ceux-là qui ont acquis et maîtrisé et à même de
transmettre les cultures traditionnelles. Dans la réalité, ce sont les
personnes âgées, particulièrement les vieilles femmes, qui sont les véritables
détentrices du savoir et de la sagesse
locale, cest-à-dire la littérature orale et la musique
ancienne. Elles sont souvent dun accès difficile, y
compris pour les jeunes désireux acquérir par apprentissage leurs
connaissances : elles seffacent derrière un silence
absolu dont lépaisseur est relative à leur ignorance du
processus actuel de développement.
Mouloud Mammeri, ce défricheur de savoirs, a pris
conscience de « la mort absurde » des cultures et des langues quand
de fausses allégations, discriminatoires, excluaient aux autres langues toute
prérogative attachée à ces dignités :
-
Elles ne
seraient pas traditionnelles et sont donc
impures ;
-
Elles ne
seraient pas langues de raison (ou de religion) et sont par conséquent
irrationnelles et incohérentes, comme si la raison qui tire sa validité de la
religion, était rationnelle et cohérente ;
-
Elles ne
seraient pas riches, donc ne seraient pas florissantes, cest-à-dire ni commodes ni pratiques ni libres ;
-
Elles nauraient pas léclat de raffinement que
confère habituellement la beauté ;
-
On leur
conteste luniversalité et tout accès à luniversel et à lesthétique.
La beauté contient tous les ingrédients que consacrent ces
attributs. Elle a pour corollaire lharmonie, cet équilibre architectural, cette régularité qui coule delle-même, ce charme séducteur et recherché. Elle est porteuse de
valeurs civilisationnelles. A lopposé, y compris le
berbère, on est confronté à la vulgarité, à labsence de
distinction et de délicatesse, au vulgarisme propre aux personnes non
instruites, à la grossièreté, à la trivialité, à laversion
répandue des connaissances. De la langue, de la culture, personne ne sait ce quest la beauté ni à quelle unité pourrait-on mesurer son apparente
beauté. Une langue qui se présente comme pure serait inhérente à une haine de létranger perçu comme source pathogène.
Cest Pascal qui disait que « la
mode et les pays règlent ce que lon appelle la
beauté ». Dans les cités kabyles, en Algérie, il
est une expression qui traduit cette situation : « w ikem icekren a tislit ? D yemma tehder xalti !» (Qui
a loué ta beauté, mariée, pour te rendre épousable ? Cest ma mère en présence de ma tante !). La beauté se
traite donc à lintérieur du cercle familial ou
territorial. Tout ce qui est en dehors, « d abrid n baylek »,
cest la voie publique, la périphérie, où chacun jette ses
souillures.
Ces aberrations sappuient sur une erreur conceptuelle dès le commencement : il ny a pas plus de langue et de culture que de discours. La langue et la
culture sont energeia, c'est-à-dire une faculté dagir,
dactiver, de produire un effet (eg, er, aru, arew,
issin, exdem, jaεl, fεal). Elles sont donc des produits dont le résultat
procède du processus dune opération humaine. Langue et
culture seraient par conséquent des activités en continuelle transformation. La
langue en somme est une réalité imperceptible hors de sa production en
discours, lui-même étant le produit de la culture. De cet axiome, la
littérature quelle soit orale ou écrite, se présente
aussi nécessaire à la langue que la langue à la littérature.
Mouloud Mammeri savait déjà tout ça depuis quil écrivait à 19 ans La colline oubliée ou quand il
traitait en 1938 de La société berbère. Grâce à son érudition et à sa
rigueur, il a su restituer à la langue et à la culture amazighes (tameslayt
d yedles imaziγen),
du Djurdjura au Gourara, du Moyen-Atlas aux Aurès, du Chenoua à la Pentapole
mozabite, du Rif à lAhaggar et à lAïr,
du mont Néfoussa à lAdrar des Ifouras, leur dignité, leur
fierté pour leurs origines plusieurs fois millénaires, leur unité dans la
diversité. Que le discours littéraire soit ancien ou récent, de facture
traditionnelle ou moderne, quil soit produit par des
personnes centenaires ou par des jeunes, quil soit
féminin ou masculin, quil soit oral ou écrit, Mammeri a
rendu le verbe (qui dit verbe dit vers) amazigh beau et élégant sans larrogance ni la suffisance de la beauté ; il la rendu noble et élevé sans larrogance ni la
suffisance de la noblesse ; il la rendu pieux et
imprégné sans larrogance ni la suffisance de la
piété ; il lui rendu lénergie sans larrogance ni la suffisance de la force ; il lui a rendu la raison
sans larrogance et la suffisance de la religion
En se libérant du jugement des autres, il a libéré le
discours amazigh (langue, culture et histoire) : « Cétaient les autres qui nous jugeaient alors quon était le sujet et la matière. Pour les autres notre présence était
transitoire, ludique, secondaire et exotique. On na
jamais été les véritables sujets des problèmes posés » confiait-il dans sa dernière interview. Lengagement était pour lui « une source vivante de
réflexions, une protestation de lintelligence
contre la violence. » Non pas « une sorte
dembrigadement inconditionnel » où « mille voix dociles bêlent à lunisson la voix de leur maître, quel immense bêlement bien sûr, mais
aussi quel bâillement immense. »
Les progrès de lethnographie, de lanthropologie, léveil des nations et des peuples du Tiers-monde après la
décolonisation, les travaux de lUnesco ont favorisé le
développement de la notion de culture et à prouver que les cultures des
peuples africains, asiatiques et latino-américains ont une qualité intrinsèques
et une richesse qui leur sont propres. Dans lesprit des
séminaires organisés par Mouloud Mammeri, quand il était directeur du Crape
(Centre de recherches anthropologiques, préhistoriques et ethnographiques),
étaient discutés les problèmes afférents à la validité épistémologique ainsi quaux présupposés idéologiques de lanthropologie
classique, avec comme perspective plus humaine la définition dune anthropologie dont les pays du Tiers-monde ne seraient plus
seulement les sujets mais les acteurs. Mouloud Mammeri part délibérément des Poèmes
kabyles anciens et ne se dissimule pas « toute lambiguïté et en quelque sorte le caractère impure de lentreprise ». « Une maintenant
longue pratique de la culture des autres fait de moi, dit-il, un porteur
plus perverti quaverti. »
La culture algérienne sen est sortie grâce à lhomme
éloquent quil était, qui a su trouver, pour reprendre
Pierre Bourdieu, « la langue elliptique et claire qui convient pour
rendre la poésie suprêmement savante et authentiquement populaire des aèdes
berbères ». En Kabylie, dans le Hoggar ou le Tassili, dans le Gourara,
le travail denquête, danalyse, de
critique et de jugement sur les plans ethnographiques et philologique auquel lanthropologue sengagea pour organiser
rigoureusement le recueil le plus complet, le plus précis de la littérature
orale amazighe jusque-là conservée par le souvenir, fait que Mouloud Mammeri ai
voulu transmettre un message, en deçà et au-delà des messages délivrés par les
poètes eux-mêmes, plus secret. En un temps où les derniers porteurs de la
culture amazighe, vouée par une sorte de fatalité historique au statut de
« culture seconde », de « culture des marges » ou
« des périphéries » sont confrontés aux verdicts hautains dune lointaine technocratie, il nest pas inutile
de faire revivre la figure de Youcef-ou-Kaci ou cheikh Mohand, ces maîtres de
la culture populaire qui fondait son ascendance de ce quelle
se commettait en donnant au sens commun une sentence spécifique. Il sen explique : « Beaucoup de pièces, que je consigne ici
comme des documents morts, sont venues à moi magnifiées, inscrites dans le
dense contexte dune culture hors de laquelle ils
sont mutilés et éteints. Certains sont inscrits dans mon esprit avec le timbre
même de la voie maintenant morte qui me les a un jour révélés. Aucune analyse,
avec des instruments élaborés ailleurs et, fut-ce inconsciemment, pour dautres desseins, ne pourra prévaloir contre cela, qui nest pas seulement une expérience vécue mais une raison dexister. »
A la raison dexister, Dda l-Mouloud a souffert de la violence : à la violence
coloniale, lAlgérie indépendante na
pas fait mieux que perpétuer le fait colonial au nom dune langue et dune unité arabes mythiques, comme si cétait les
chants polyphoniques de lAhellil du Gourara ou les Poèmes kabyles anciens qui pouvaient les remettre en
cause. Tout le monde connaît la suite des événements qui ont enfanté le
Printemps amazigh en 1980 et le Printemps noir en 2001. Le même processus de la
thèse du complot extérieur jamais remis en cause, part du postulat de la
manipulation.
On sait que la violence, en tant que force brutale pour
soumettre quelquun, met en scène deux acteurs, « loutrageur » et « loutragé ». La
violence nest quun procédé, parmi dautres possibles, de réaliser à dessein un projet. Le
« violenté » est expressément nommé, alors que la « force
brutale » correspond à ce que la sémiotique appelle la modalité du « pouvoir-faire »
(tazmert i wemyag), même quand cette formule prend une valeur
cognitive. Le violenté va passer du « pouvoir-ne-pas-faire »
(tazmert i war amyag), où il a la liberté de pouvoir, au « ne-pas-pouvoir-ne-pas-faire »
(war tazmert i war amyag), où il subit le pouvoir de contrainte. Ce qui
définit un viol nest pas forcément lacte proprement dit mais le
non-consentement. La contrainte prend la forme dun
pamphlet dans le quotidien gouvernemental El Moudjahid.
Dans son roman La Traversée, Mammeri, dans une
écriture prémonitoire, donne une vision fine et perspicace sur la révolution
algérienne à travers le personnage de Mourad, ancien maquisard et journaliste à
Alger Révolution, nom quelque peu lyrique et sentencieux de cette
ténébreuse révolution qui se maintient encore dans le gratin officiel pour se
réserver le pouvoir. Cest là lart et la
manière de se moquer de El Moudjahid que
les Algériens dénomment « R.A.S. », « rien à signaler ». Le
héros est présenté comme le partisan propre et parfait parmi les rares qui ont
survécu à la guerre indépendantiste : « Mourad pouvait aussi
entrer dans un ministère, chasser lindice, pêcher
à la ligne, pêcher tout court, faire la rue, la vie, lamour
histoire doccuper le temps, mais rien de tout
cela ne le tentait.» Sachant les enchaînements de la lutte pour lindépendance
avec la sauvagerie des combats et les abysses des intrigues et des séditions
internes à la révolution, Mourad, dans un dernier article, « La traversée
du désert », analyse lAlgérie, ses traquenards et
ses intrigants, avec lélégance de lécriture.
La marche de la caravane (la révolution) met sept mois (sept ans), pour
traverser le désert (la lutte armée), pour atteindre loasis
(lindépendance et les richesses du pays), parce que le
soleil, les hyènes, les vipères, toutes sortes de maladies, la soif et la faim
(les traîtres, les complots, les liquidations et les décisions obscures)
handicapent son processus. Les héros, qui se donnent corps et âme à la
révolution, loin de compter et supputer leurs peines, abreuvent le terrain de
leur rôle et de leur sang, offrent jusquà leur dépouille,
mais ignorent que tout se conçoit et se spécule derrière leur dos : les
manuvres des caravaniers, les chefs de la révolution, restent pour la plupart
secrètes et les décisions prises à huis clos restent occultes. Mais écoutons lécrivain :
«Comme toujours dans pareil cas, en tête [de la caravane]
marchaient les héros. Seuls et exaltés, ils occupaient les jours à taillader
des obstacles toujours renaissants et les nuits à compter les étoiles. Pendant
quà lavant les héros,
téméraires et distraits, tombaient par gerbes entières, derrière eux, le
troupeau agglutiné suffoquait dans sa laine et la chaleur du soleil, mais il
prenait bien soin de rester soudé. Le destin des héros est de mourir jeunes et seuls. Celui des moutons est aussi de mourir, mais
perclus de vieillesse, usé et, si possible, en masse. Les héros sautent dun coup dans la mort, ils y
explosent comme des météores dévoyées, les moutons saccrochent à la vie jusquà la dernière goutte de
sang. »
« [
] Les caravaniers avaient fort à faire. [
]Ouvertement
ils déploraient de voir quà lhorizon
la troupe des héros faisait peau de chagrin ;
obscurément ils calculaient les moyens les plus justes et les moins voyants de
se débarrasser des derniers, une fois loasis atteinte.
Les plus malins disaient quil suffirait dabandonner les héros aux pièges féroces de la paix
»
Dans la théorie du complot avancé, la chronologie des
faits nest pas perçue comme un mécanisme qui
engendre ses propres mouvements et ses formes constantes quaucun protagoniste nest tout à fait en mesure de
maîtriser, mais qui échafaudent des combinaisons demprise
de pouvoir, des ascendants de domination, ainsi que des contestations qui sorganisent en opposition. La théorie du complot peut être synthétisée
en une manuvre dont la genèse est antérieure et extérieure aux enjeux
politiques, économiques, sociaux et culturels, tels quils
se présentent ou se donnent à voir. Dans cette vision des choses, les tenants
du pouvoir mettent en uvre un schéma métahistorique qui transpose lhistoire sans quelle en soit affectée, assistés
de manuvriers quils déploient à leurs fins et capables
de surveiller, activer, manipuler, contrôler et coordonner les gestes et
mouvements dactants pas forcément acquis à la cause.
Dès que la liberté nest pas acquise pour le destin de lhomme, sa
pleine expansion, le rôle de lintellectuel « Et
en tant que romancier, ce qui mintéresse surtout,
cest le destin de lhomme, sa
liberté, sa pleine expansion ; cest justement de
crier que quelque chose manque à cette plénitude (
) Sans
cela qui remplirait cette fonction ? » sinterroge Mouloud Mammeri. « Mais vous connaissez cette
formule : Que la République était belle sous
lEmpire. Cest
toujours comme ça. Les gens qui ont fait la révolution avaient certainement des
images belles du futur, que les événements réels, que la réalité ne peuvent confirmer. (
) Mais encore
fallait-il que quelquun le dise
Eh
mon Dieu comme je navais plus rien à attendre, comme javais un certain âge, il a fallu que ce soit moi qui le dise, et
voilà. » Dda l-Mouloud nest
pas tombé dans le piège de lanalyse fossilisante de limmobilité des choses, il a rempli cette fonction de passeur et cest lui qui a crié le manque
pour atteindre la plénitude.
Ecrivain de talent, anthropologue anticonformiste,
intellectuel captivant, polémiste de génie qui a toujours pris la voie juste et
des comportements courageux dans les situations difficiles des années de
plomb sur les questions de lidentité,
de la langue, de la culture et de lhistoire des
Imazighen, il revenait à Mouloud Mammeri de rappeler, Après trois ans, dans
la série spéciale de Tafsut n°1 de décembre 1983
que :
«
les faits ont montré que, quoique laction ait
été doublement limitée : géographiquement parce quelle na pratiquement intéressé que les deux
Kabylies et en partie Alger, thématiquement parce quelle portait essentiellement sur la revendication de la langue et de la
culture berbères, en tant que composantes à part entière de lidentité nationale, ses effets ont concerné le peuple algérien tout
entier.
«
le Mouvement dAvril a fait ressortir limportance que le peuple algérien accorde à la culture et dabord il convient de le préciser à sa culture. Il a ainsi permis par son action de définir cette notion
mieux que navaient su le faire damples
et savantes dissertations théoriques. Il a en particulier rejeté deux
conceptions erronées qui malheureusement continuent de sévir encore :
« La première est de croire que la culture se
décrète. (
) On ne créé pas une culture à coups dordonnances, on ne lenferme pas dans une maison de la culture, ni dans des programmes hebdomadaires soigneusement et surtout
strictement contrôlés, ni dans la parenthèse vite fermée dunesemaine culturelle où on
se sert en vrac quelques succédanés. La culture vit de liberté. Elle est lexpression la plus haute et la plus authentique de la vie dun peuple. Elle fait partie de son existence la plus essentielle, comme
lair quelle respire, comme le pain
et leau. Elle émane de sa vie, de ses problèmes, de ses
rêves, de ses espoirs et y ramène
«
la revendication de la culture berbère constitue un élément positif
primordial du Printemps de Tizi. Il est clair, ce disant, que la culture
berbère nest pas la propriété exclusive des seuls
berbérophones. Elle est le bien de tous les Algériens, parce quelle a contribué (et continue de le faire) à la constitution de leur
identité dans une proportion beaucoup plus grande que beaucoup par ignorance ne
le croient. (
)
«La seconde conception erronée de la culture populaire
consiste à la confondre avec le folklore. Le mot chez nous est dimportation la chose aussi
malheureusement. Le folklore cest la notion péjorative et
méprisante de la culture du peuple, une notion en réalité idéologique (au
mauvais sens du terme), dont les effets néfastes ne sont pas à démontrer :
en convaincant le peuple (et les autres) que son authenticité gît dans ces
sous-produits de la culture. (
)
« En second lieu le Mouvement dAvril a posé pour la première fois le problème toujours
occulté de la définition de la démocratie (
), mais
diversement interprétée. A la question implicitement posée, il est naturel quAvril apportât une contribution déterminante. La démocratie constitue
en effet un élément fondamental de la société berbère sous toutes ses formes,
que celles-ci soient la cité mozabite, le village chaouia ou kabyle ou la tributouarègue. Les décisions concernant la vie
de la collectivité se prennent au sein dassemblées où
tous les citoyens sont représentés. (
)
« Une expérience millénaire a fait de la pratique
démocratique et du respect de lindividu un réflexe profondément intériorisé. Cest
dire que le peuple ne peut confondre la démocratie avec ses caricatures et les
manipulations dont elle fait lobjet.(
)
« [Le Mouvement dAvril] a permis de restituer à lhistoire
algérienne sa véritable dimension. La nation algérienne
ou maghrébine dune façon générale
nest pas née dune génération
spontanée, il y a à peine quelques siècles. Lhomme de
Ternifine, qui en son temps témoigne dune civilisation
avancée, date de 700 000 ans, ceux qui ont construit les milliers de
dolmens algériens, ceux qui ont peint les admirables fresques du Tassili,
Syphax, Massinissa, Jugurtha, Tacfarinas, Gildon, Firmus, Antalas, Yarbas, le
Tombeau dit de la Chrétienne, le Medracen, les djeddars de Tiaret, la Kahéna,
Koceyla ne sont pas seulement des références symboliques, aussitôt oubliées quavancées. Avec dautres composantes, ils nous ont
fait ce que nous sommes. (
) »
Au-delà de lhommage qui est rendu aujourdhui à ce grand homme
qui pourtant resta toute sa vie simple et modeste, bon et généreux, au-delà des
campagnes internationales menées et le soutien apporté par lUnesco pour la protection et la sauvegarde du patrimoine universel,
particulièrement dans le domaine de la civilisation matérielle à travers des
sites archéologiques, des villes au passé culturel certain et des monuments
classés historiques, Mouloud Mammeri conscient de la disparitions à une vitesse
vertigineuse des langues et des cultures orales, sest
empressé de « happer » les brandons des derniers feux.
Six préfaces par Mouloud Mammeri :
1°)
_ 1973_ Préface à louvrage de
Manuelle Roche Le MZAB, architecture ibadite en Algérie, éd. ARTHAUD, Paris,
1973
La beauté leur fut donnée par surcroît. Les puritains hétérodoxes
partis vivre leur vérité parmi les sables plutôt que de consentir dans
labondance à celle des autres, navaient pas souci de chercher le beau pour
lui-même en leur demeure. Non point quils nen eussent pas le goût, mais parce
quils nen avaient pas le loisir. Dabord survivre. Le MZab est un exil
dexil les Ibadites, qui les premiers sont venus occuper la Chebka, ont dabord
quitté Tahert pour Isedraten aux six cent mille palmiers, puis ils ont renoncé
à la douceur de leur nouvelle patrie, à ses stucs, à ses sources, pour aller
délibérément sinstaller en une vallée que la crue oublie pendant des années.
Cest dire que davance ils sinterdisaient le caprice et la gratuité, voire la
simple distraction. Contre les hommes et face aux éléments il leur a fallu
vivre arc-boutés, tendus, agglomérés aussi. Cest le caractère des hommes,
cest aussi celui de larchitecture. Rien de plus concerté, voulu, mesuré. On
ne vit pas à contre-courant de tout lenvironnement sans une conscience aigüe
et quotidienne de toutes les conditions dexistence. Lart des Ibadites est
condamné à la vigilance.
Mais que lon ne sy trompe pas, car à qui peut être tenté de conclure que
lart du MZab volontiers devient artifice, il suffit dun séjour, même bref,
au milieu des venelles étroites des cités de la Chebka pour se convaincre du
contraire. Car ce que dabord éprouve celui qui a choisi dy demeurer, cest
justement le sentiment dy vivre en accord. Avec quoi ? Cest ce quà pénétrer
les cités du MZab on finit par clairement concevoir.
7.
Beni-Izguen, de loasis.
Bien sûr, la pentapole est
le résultat dun divorce, mais ce divorce était le signe dune fidélité plus
profonde et comme à de plus essentielles exigences. De plus en plus des voix
sélèvent par-delà les régimes et les idéologies pour crier gare à des hommes
emportés par lélan dun progrès et dune technique quils contrôlent de moins
en moins. De plus en plus lhomme perd le contact de la nature, les espaces
verts cèdent devant la ville envahissante, des espèces vont se perdant, lair
se pollue, lhorreur du béton et des architectures de fer, du sable loti au
mètre carré sur lequel nous nous resserrons sagement lespace dun été, de plus
en plus devient la norme. Notre science chaque jour plus précise et plus
puissante, sous couleur dhumaniser le paysage, en fait une image de cauchemar;
rien de plus inhumain que la nature humanisée par nos machines. Cest pour cela
que cest à peine un paradoxe si des architectes sortis des villes les plus
savantes, les plus sophistiquées, jamais construites de mémoire de
civilisation, se sont trouvés, divine surprise, conquis par la soudaine
apparition de cinq petites cités incrustées de main dhomme et à sa hauteur, le
long dune simple vallée perdue dans limmensité dun désert où rien ne
semblait devoir les attirer.
A des fugitifs qui jugeaient préférable de renoncer à la douceur de vivre
plutôt quà des principes de vie, le désert aride apparemment ne pouvait offrir
que la douceur dune tombe, et voilà quil fut leur berceau. Pendant plusieurs
siècles les Moabites ont mené une vie recluse, mais recluse sur lessentiel, et
Le Corbusier, visitant la Chebka, reçut comme un choc la révélation quune
vérité cachée mais vitale était enfouie là dans la pierre.
Au vrai, il ny a là de paradoxe quapparent. MZab, pays de la rigueur
desséchante, desséchée. Un livre sur les Mozabites sappelle les Puritains du désert. Ce sest pas en vain ni par hasard que ces
fidéistes ont choisi de loger leur foi nue dans la nudité de ce paysage où rien
ne pousse qui distrairait lhomme de la contemplation épurée de son
Dieu. Le tout est de juger ce que les hommes ont tiré de leurs options.
Or un Mozabite lit dans sa façon de simplanter au sol la totalité de son
destin, et aussi son sens. Avec des murs, des pierres, une distribution des
masses et des propwtions, il se de7init dans toutes les directions.
Larchitecture de la Chebka définit dabord les rapports des hommes entre eux.
Ghardaia exceptée, toutes ces cités ont la dimension dun bourg, et le prestige
semble disproportionné à la dimension. Oui, mais nous sommes en un pays où la
valeur se mesure è la densité ; ici, la statistique et les chiffres
sont dérisoires. En chaque ville du MZab, .si petite soit-elle, il y a
juxtaposition de plusieurs quartiers, plusieurs plans, qui entretiennent entre
eux des rapports complexes de complémentarité antagoniste, multipliant ainsi
par un coefficient considérable le sentiment dexistence sociale que peuvent
prouver qui y demeurent.
Tous ensemble les Mozabites se définissent aussi par
rapport aux autres. Cinq à kilomètres à peine séparent leurs villes lune de
lautre, une portée de voix, beaucoup quune étape de piéton. On est dun
quartier, dun clan, dune « gens », mais à lintérieur dune masse
compacte de demeures dont une enceinte rigide marque la limite lapidaire avec
le monde des autres. Par-delà les murs il y a encore les
sables.
Enfin, par-dessus la diversité des groupes humains il y a lunité de
Dieu, et dans la pierre le Mozabite inscrit le rapport qui le lie au principe
qui fonde toutes les valeurs et en qui se fondent toutes les oppositions.
Dominant la tourbe serrée des maisons basses, comme plus arasées dêtre couvertes
dune terrasse, le minaret de la mosquée, souvent unique, sétire comme lélan
vers le ciel libre et la tension de lAbsolu. Cinq fois par jour la voix
monocorde et impersonnelle qui sen échappe pour appeler les fidèles à la
prière place aussi la cité des hommes dans la dimension nouvelle de la
transcendance.
Et enfin, sagesse profonde dun monde accordé, lhomme ici sait que souvent qui
veut faire lange fait la bête, quaprès avoir défini ses rapports avec les
autres, avec ses frères et avec Dieu, lindividu a besoin de se retrouver dans
le secret de soi et comme de sy retremper. Pour cela il a aménagé ces demeures
closes quun mur aveugle offusque vers les rumeurs du dehors, ses servitudes et
ses conventions. Même passé la porte, le vestibule ménage encore le dernier
paravent dune entrée en chicane. A toujours vivre au-dehors on risque de
perdre le souvenir et bientôt le souci des exigences profondes. Des murs épais
protègent le recueillement quotidien de vies qui sans cela se dilueraient dans lagitation
stérile de la place du marché. Ainsi un mouvement pendulaire assure lharmonie
profonde des individus qui passent de la retraite des demeures, où lon
retourne à lessentiel de soi, aux confrontations fécondes de la place où les
hommes en se mêlant senrichissent.
Je vois bien que tout cela est menacé. Cinq petits bourgs, lovés au fond dune
vallée qui nétait perdue quau temps des caravanes, ne sauraient résister au
poids, aux tentations et souvent aux nécessités dune civilisation devenue planétaire.
Les Mozabites eux-mêmes ont hâte de changer tout cela; ils le changeront, cest
sûr. Il reste à espérer qui, sous couvert des
changements de surface, ils demeurent fidèles à une vocation déjà éprouvée. Une
fois déjà ils ont, et pendant des siècles, réalisé comme le nombre dor de la
formule que depuis des millénaires les hommes vont quêtant avec des fortunes
diverses mais une obstination jamais lasse : la formule dun homme accordé
tout à la fois aux choses, à lui-même et à Dieu. Au prix dun miracle, à bout
de ras maintenu.
Soit ! Est-il outré dattendre
que le miracle de nouveau se réalise?
MZab secret dune vérité perdue.
MOULOUD MAMMERI.
2°) _ 1973 _ PREFACE DU DISQUE 45 TOURS
« BABA-INU BA » PAR M. MAMMERI
Dehors la neige habite la nuit. Lexil du soleil a suscité nos frayeurs et
nos rêves.
Dedans, une voix cassée, la même depuis des siècles, des millénaires, celle
des mères de nos mères, crée à mesure le monde merveilleux qui a bercé nos
ancêtres depuis les jours anciens.
Le temps sest arrêté, le chant exorcise la peur, il crée la chaleur des
hommes près de la chaleur du feu. Le même rythme tisse la laine pour nos corps,
la fable pour nos curs.
Sétait ainsi depuis toujours, pourtant les dernières veillées en mourant
risquaient demporter avec elles les derniers rythmes.
Allons-nous rester orphelins delles et deux ? Il faut savoir gré à
celui qui, habillent à la fois moderne et immortel les vers fidèles et beaux,
prolonge pour nous avec des outils très actuel un émerveillement très ancien.
Cest en vain que dehors la neige habite la nuit.
MOULOUD MAMMERI.
3°) _ 1981 _ Préface au 1er roman amazigh
« ASFEL » de Rachid
Aliche, éditions FEDEROP, 1981
Depuis la prodigieuse invasion de lécrit à tous les domaines de notre
vie, des peuples entiers ont pu passer pour aphones, justement parce quils nen disposaient pas. Dans littérature il y
a lettre: comment des sociétés où celle-ci manquait pouvaient-elles avoir
celle-là? Ainsi en est-il allé de la société berbère pendant des millénaires,
exactement depuis que, douze cents ans avant lère chrétienne, des marchands
phéniciens sont venus établir sur la côte tunisienne le premier comptoir
apparemment anodin, voire pacifique. Les colonisations nont plus cessé depuis
de se suivre lune lautre: il y en a eu sept exactement, jusqu à la
française, la dernière en date.
Pendant trois millénaires, les cultures
légitimes de lAfrique du Nord ont été toutes allogènes, implantées tant bien
que mal sur le vieux sol, où le berbère était acculé de plus en plus à lexil
intérieur; les cultures... donc aussi les langues, qui en étaient le signe exemplaire, parce que quotidien
et immédiatement perceptible. Pendant toute cette étendue considérable car
trois mille ans, même en termes dhistoire, ce n est pas peu, surtout si lon
songe que chaque colonisation nouvelle trouvait pour ainsi dire le lit déjà
préparé par la précédente et, corollairement, la résistance autochtone chaque
fois un peu plus brisée pendant tout ce temps la langue est allée faisant
peau de chagrin, cédant chaque siècle un peu plus de son domaine (elle sest
parlée jadis de loasis de Jupiter Ramon, en Egypte, aux Iles Canaries) et de
ses compétences, lusage officiel la cantonnant dans des emplois ludiques,
marginaux ou domestiques. Si bien que le miracle nest pas quelle ait subi une
si longue et si diverse série dagressions, mais bien quelle leur ait survécu,
insulaire, tronçonnée, meurtrie, cantonnée dans les usages aléatoires ou
déficients de loralité, mais toujours vivace.
Les
progrès décisifs accomplis depuis quelques décennies dans divers domaines (en
particulier la science politique, la linguistique, lhistoire) ont donné aux
peuples sans écriture la possibilité déchapper enfin à la malédiction
ethnologique. Les peuples naguère encore considérés comme aphones, parce que
leurs créations étaient suspendues au fragile support de la parole et de la
mémoire, avec tous les risques que cela comporte, peuvent maintenant fixer dans
la lettre linévitable fluidité de la voix.
Cela ne va
pas toujours sans péril ni difficulté Linstrument na pas été rôdé par un long
usage (du moins pas pour cette forme particulière dexpression qui est
1écrit), les destinataires sont plus rompus à être des auditeurs que des
lecteurs, les canaux de diffusion doivent le plus souvent être inventés. Le
défrichement d une terre vierge sous tant de rapports est oeuvre ardue. Cest
pourquoi il faut savoir gré aux pionniers qui, comme Rachid A liche,
entreprennent lexploration de la terra incognita
La
quasi-totalité des textes berbères édités jusquici (j entends ceux qui visent
à quelque valeur littéraire) sont des textes poétiques. Les contes rnême sont
dune littérarité impure. Le récit (mais en est-ce vraiment un?) que propose
aujourdhui Rachid Aliche est en prose ; cest à ma connaissance le
premier du genre, en tout cas de cette importance. Le mérite nen est que plus
grand davoir fait servir à un dessein moderne un dessin enraciné dans une
tradition vieille de plusieurs siècles.
Ce que
Rachid Aliche rend ici en berbère moderne, il aurait bien sûr pu le dire dans
une des grandes langues écrites (il en a certainement au moins une à sa
disposition). Peut-être pour se dire lui fallait-il plus quun instrument
ductile, une musique tissée aux battements mêmes de son sang dans ses veines,
peut-être, comme le dit lexergue de son deuxième chapitre, trouve-ti-l plus de
goût à la farine du gland avec sa cupule quau beau couscous de la honte.
Peut-être sera-ce aussi le goût de ceux qui liront ce texte avec lespoir dy
trouver ce que suggère le titre : asfel, le remède magique.
Mouloud MAMMERI
4°) _1982 _ Préface Amawal n tamziɣt tatrart, 1982,
édition IMEDYAZEN, Paris, 1982
TAZWART
Zik, asmi mazal
timacinin agi yakw d-innulfan mazal ur kciment ara kul ddqiqa n tmeddurt nneɣ,
aaud kul aɣref izmer ad yidir ɣur yiman-is kan, zemren ad εeddin
wagguren d iseggwasen annect ur iẓerr lǧiran-is ur iseil yes-sen.
Assagi deg telḥa tussna, alarmi ma yeḍra kra ssbeḥ di
Marikan tameddit ad yaweḍ lexbar lberr merra, tuyal ddunit
t-taxliǧt. Tamubilat, isufag, tilifu, tilibizyu xaḍent akw gar
timura alarmi, ayen yeḍran ɣer wemdan tǧaεleḍ
ibεed ur k-id-ibbwiḍ ara, di tilawt yeεna-k ula d
kečč, ama d abaɣur, ama d acaqur. Bnadem l-lεali idεa
d ayen ilhan kan ara t-id yawḍen si lɣir.
Nekwni s Imaziɣen, ma nella zik wa deg wedrar wa di sseḥra
neǧεel iman- nneɣ nḍerref ur nebbwi ḥed ur aɣ-d
ibbwiḍ ḥed, assa liḥala tbeddel s abaɣur. Ibbweḍ-d
yimir ideg akken tella lḥala n ddunit a-ţ-netbeε ula d nekwni.
Ladɣa assa di ddunit tussna tezreε tsahrew, ulac taɣawsa
iwimi ur d-tufi ara abrid, neɣ iwimi ur la tekkat ara ad d-taf abrid.
Yiwet di tussniwin iferken assa aṭas gar waggagen t-tasnilsit. Ihi
tasnilsit, mi teɣra tameslayt tessefsi akw ayen illan degs, tezmer ad
treqqeε ayen ixusen degs, ad tessefsu ayen zegzawen degs.
Acku tṭerru d tmeslayt akken tṭerru d yimɣan. Iger ma
teǧǧiḍ-t tallit ad teẓd akw teẓgi fellas, alamma imɣan
isεan lmeεna ad ten-testiqqef. Ilaq ad as-teṭtfeḍ lmaεun
d lmezber alamma yuɣal wakal d aftatas, lfakya tebyiḍ ad
ţ-id-yefk.
Ihi yas lḥala n Tmaziɣt assa d tin ggiger ɣef tuli teẓgi,
llan iberdan di tussna wwassa ara ţ-id-isidren alarmi tuɣal
mačči kan am akken tella zik di laṣel is, maca ugar bbwakken tella.
Akken i nexdem i umawal a. Neẓra
ay gxuṣen aas di tmaziɣt d awalen n ddunit n wassa, neɣ awalen
n tɣerma. Ihi nenuda tiktabin akw iţwarun yef tmaziɣt (neɣ
s tmaziɣt), i tebɣu tili tutlayt, neddem-d segsent awalen nwala laqen
i tɣawsiwin illan assa. Tutlayt seg d neddem aṭas d Tamaceɣt,
acku d neţat i geṭtfen ugar n wawalen n Tmaziɣt, maca ula si
tutlayin nniḍen n tmaziɣt, mi nufa awal ilaqen nawi-t-id. Igwra-d
nera belli amawal icban wagi aṭas i-t-ixusen. La neţheggi amawal
nniḍen ara yagwaren wagi s waṭas. Maca winna ilaq-as akud, ilaq-as
tiwizi. Di teswiεt-a iḥar cweyya lḥal, nuzzel kan s ayen
izerben. Sya s azekka ula d wagi ad yaweḍ yimir-is.
Awal aneggaru. Nebɣa ad nesefrek
tamaziɣt, ur nebɣi ara ad nezzi s weεrur i tmeslayin
nniḍen akw illan di ddunit, ladɣa tiden ideg telḥa tussna
wwassa. Skud akka mazal tamaziɣt ur tebbwiḍ ara akken ad iɣer
degs umdan d amedya ayen iwimi qqaren s tefansist lélectronique neɣ
léconomie ilaq-aɣ ad nɣer timeslayin tiberraniyin. D acu kan, ur
ilaq ara ad nexdem am akken s iqqar winna n zzman axxam is ur werǧen
tefriḍ, lǧameε teṭtef-as amezzir. Mi nressa llsas
wwexxam-nneɣ ɣef sseḥ assen ad as-nelli tibbura d ṭtwaqi
iwakken ad-d tεeddi tafat, ad ihub ubeḥri, ad imerreḥ
yeẓri di tɣara d tihisi-s. Assen ad teḍru yidneɣ am win
iffuden yeswa, neɣ am win ilḥan aḍan d wussan gar idurar d
icuqar ar deqqal iffeɣ-d seg xenduq izger tiṭ is, zdat-s d azayar d
alma n tuga ifsan.
Ayen ? acku
liḥala n Tmaziɣt wwassa d analkam umezruy Imaziyen, ayen ixdem
umezruy, izmer umezruy a-t-id ireqqeε.
Amek d tebbweḍ Tmaziɣt s anga
ţ-neţwali assa ? Teţmeslay seg umda Isiwan di tmurt n
Maṣer (ɣer wegmuḍ) alamma d tigzirin Tiknaryin (ɣer
utram), seg ill Agrakal (s agafa) alamma d tamurt Iberkanen (ɣer
wenẓul). Seg akken hrawet tmurt (ger Isiwan d Teknaryin : igiman n km i
yekkan) iban ad temxillef tmeslayt seg uemkan ɣer wayeḍ.
Rnu ɣef-ya, zik akal-agi yakw
iddukwel, mlalent tmura ta ɣer ta, armi, ɣas illa lxilaf, ur meqqer
ara aças. Anza uyagi lqern qbel Mas Σisa, yuzen-as ugellid Yugurten si
Qsentina yiwen uneɣlaf isem-is Asfar i uḍeggwal-is, agellid Buxuc di Merruk, iwakken ad
t-iεiwen di teɣlift n tgelda. Iqqim-n Asfar acḥal, iban belli s
tmaziɣt i yeţemsefham neţa d ugellid Buxuc, mebla ma yella din
kra n yelɣi.
Syin ɣer da tebḍa
tmaziɣt d tigemmucin Seg assen i d-ibda lxilaf ameqqran acku mkul
tagemmuct tebda teţbeddil tameslayt iwakken ad ţ-terr d tin iwufqen
tameddurt deg tella, armi alamma si tannumi neɣ si tmeɣri ara yefhem
uqbayli tacelḥit d amedya. Irna, ayen ugaren aya, mkul tutlayt
teṭtef kan imeslayen i das-ilaqen. Wiyaḍ imi ur
ten-teḥwaǧ ara, ur ten-tessexdam ara, teǧǧa-ten ɣlin.
Maca lxilaf-nni assagi yeggwra-d di
lfayda. Acku kul tutlayt d imeslayen teṭtef. Ihi ma yella d amedya ixus
wawal i temẓabit tezmer ad truḥ ad t-id-tawi ansi nniḍen,
anida mazal-t yella.
PREFACE
Ce
recueil répond uniquement dun besoin pratique. Plusieurs siècles de
confinement dans les usages uniquement oraux et pour ainsi dire domestiques, un
éparpillement des parlers en groupes restreints qui signoraient les uns les
autres, la présence dès les débuts de lHistoire des grandes langues de
civilisation sur la terre de Berbèrie (punique, latin, arabe, français) ont été
les causes objectives du caractère lacunaire et trop diversifié du lexique berbère.
Il y manque en particulier les termes abstraits ou plus, généralement les
termes de civilisation, cest là naturellement le résultat de conditions
historiques précises auquel les développements de la linguistique ou des
sciences humaines en général permettent désormais de pallier.
La tendance de la langue a été jusquici de combler ses lacunes par des
emprunts.
Le procédé était lui-même déterminé par létat
de subordination de fait dans lequel la langue berbère sest trouvée
différentes époques de lHistoire il fallait pallier au plus
pressé et se donner au moindre frais les moyens de survivre. Le cas est loin
dêtre singulier et la langue la plus internationale aujourdhui est faite de
lintrusion dune notable proportion de termes dorigine latine dans le corps,
dun parler germanique.
Pour des raisons quil serait trop long dexposer ici et qui tiennent les unes
à des considérations de commodité pratique, dautres à la nature même de la
langue, il a paru préférable de recourir ici à la dérivation soit de forme soit
de sens.
La méthode employée a été en gros la suivante :
chaque fois quun
terme existait dans un parler il a été adopté (ex. = tanemmirt
= merci). Chaque fois qu un terme traditionnel de
sens concret pouvait servir à rendre une notion abstraite (ou de civilisation)
de sens voisin il a été adopté (ex. = aneflas magistrat). Quand ni lun ni 1 autre de ces deux
procédés nétait possible, on a recouru à la dérivation de formes nouvelles à
partir de racine berbères existantes dans lun des quatorze parlers (ex. =
tagrawla = révolution, à partir de griwel qui a le
sens originel du latin doù a été tiré révolution). Dans
la quasi-totalité des cas on a respecté les types des formes dérivées berbères
déjà existantes. Statistiquement le parler qui a le plus servi est le touareg,
à la fois plus complet et plus pur que les autres.
Pour confectionner ce lexique, il na été possible dutiliser que des sources
livresques. Il est certain quelles sont notoirement insuffisantes, parce
quelles ne renferment quune partie réduite (et sans doute la plus commune,
parce que la plus aisément accessible) du vocabulaire réellement existant.
Seule la constitution dune équipe où figureraient des locuteurs de la plupart
des parlers et elle-même travaillant sur les données fournies par des enquêtes
quasi-exhaustives sur tous les points du domaine berbère, peut venir réellement
à bout dune tâche de longue haleine et sans doute jamais achevée.
AVERTISSEMENT
Quand le pluriel nest pas indiqué cest quil est en ien (ou tin).
Un premier inconvénient cest que les mots sont atomisés. Ils ne forment
pas un corps structuré où les termes se déterminent lun lautre. Chacun (ou presque)
étant pris dune racine (en général Touareg) particulière et seule. Cette
racine étant en général particulière au touareg néveille rien dans lesprit
des locuteurs des autres parlers, qui n ont pas le terme simple doù est tiré
le néologisme.
La solution est dès lors (peut-être) de reprendre tout le lexique à laide
du lexique panberbère et de prendre comme racines formatrices plutôt celles des
parlers du Nord les plus nombreux, condition naturellement que la racine soit
berbère.
Une deuxième objection est que le lexique est fait à partir dune langue
indo-européenne, ici le français, dont le lot sémantique ne correspond pas
nécessairement avec celui du berbère.
Mais ici il faut tenir compte du fait que les mots choisis expriment en
général des notions ou des réalités devenues mondiales. Il faut de toutes façons les exprimer. Cest du reste la raison pour
laquelle il y a ici plus de noms que de verbes et à plus forte raison que de
compositifs.
Régulariser les classes de termes : par exemple ceux exprimant les sciences
(français : noms en -logie ou -graphie), des doctrines (français : noms en
-isme) etc.
Le choix des termes à créer a été fait de façon purement pragmatique. Il y
a lieu de réfléchir sur la composition rationnelle dun lot minimum.
Car le langage est vie. La somme lexicale la plus complète et la plus
cohérente est un système de signes. Elle acquiert valeur et vie à partir du
moment où elle sert dinstrument réel de communication, dexpression, de
promotion du savoir ou de la culture. A partir de là, le lexique (et plus
généralement la langue tout entière) se nourrissent de lusage même qui en est
fait quotidiennement et il nest plus besoin de lexicographe ou plutôt son rôle
change.
Il est évident enfin que le caractère réduit de linstrument ici proposé
est voulu. Cest une espèce de minimum immédiatement indispensable. Mais,
justement pour cette raison, il semble opportun que tous les parlers berbères
ladoptent (et peut-être ladaptent) afin que le lot de termes nouveaux, de toutes
façons nécessaire, soit le même dans lensemble du domaine. Les structures
grammaticales du berbère sont remarquablement unies dun bout à lautre de la
Berbérie (de Siouah au Zenaga, pour ne pas dire au Guanche, dont nous navons
pas encore de système grammatical suffisamment connu), il serait bon quun
ensemble identique de termes modernes pallie aux diversités lexicales
anciennes.
5°) _ 1983 _ TAZWART i wungal ASKUTI
N Saεid Saεdi, éd. Imedyazen, Paris, 1983,
Sɣur LMULUD AT MΣEMMER
Yuker ḥeḍreɣ,
yeggul umneɣ
Mara imuqel bnadem ɣer
deffir s amezruy nneɣ, nekwni s Imaziyen, ad yaf d tagi i yeḍran
yidneɣ mačči d abrid mačči sin.
Di 3000
iseggwasen agi iεêddan sebεa legnas i d-ikecmen tamurt nneɣ :
Ifniqen, Irumanen, Iwandalen, Ibizantiyen, Aεraben, Iterkwiyen, ineggura d
Fransis. Akken ma llan uyen tamurt s yiɣil, maca yal yiwen issetbeɛ
timucuha i yiyil. Yal yiwen degsen ifesser amezruy i yiman is, inejr it akken
i s ilaq. Nitni day isswayen heddren, nekwni ssayen nesusum. Amezruy nneɣ
d nitni i t yuran (neɣ i t izzelgen, neɣ
t t isdergen), d nitni i iwezznen, qqaren-d ayen ilaqen d ayen ur
nlaq...Ayen ilaqen d ayen i sen ihwan i nitni. .Armi di tmurt n babatneɣ d
jedditneɣ nezga-d d iɣriben, ur aɣ d-iţawi umeddah di
teqsit alamma taqsit d tin n wiyid, nekwni texḍa yaɣ neɣ tḥuza
yay kan akka di rrif.
A ţ id-bdun d iyil, mi
yaɣ ferqen ad aɣ rẓen a-ɣ-ţhuzzun di dduḥ n
tmucuha nsen. Wa yeqqar aɣ: Si Ḥimyar i d-tefrurim, nusa-d ɣurwen
d zzyara n gmas ɣer gmas, irna newwi yawen-d rreḥma: ama sseεd
nwen kunwi yeddren armi kwen-id-qesden watma ɣef ur tebnim ! Maca...
Maca tḥedder-d
tideţ, u, mi d-teḥder tideţ naf tagmaţ issafeg iţ waḍu,
Ḥimyar nni seg d-nefruri
la yeqqar : «Iwimi-k ke imi d nek lliɣ?».
Nufa-d
qqaren : « Sawleɣ i wayla n medden, ar assa la t ţraǧuɣ,
sawleɣ i wayla-w yenna-k : Aqli ! »
Ihi, ma yella wiɣeflen zik, assa ur d-iqqim ara wemkan i lekdeb,
acku lekdeb taswiεt kan i yeţalas; s lqerb neɣ s ṭtu1
yiwwas tideţ a t teɣḍel, acku tideţ am zzit : i tebɣu
tiɣzifeḍ a lweqt, labud yiwwas a-d-tifrir.
Maca nufa-d qqaren: « Taekkwazt ad ak
ţ-rquɣ rnu-yas aseḥlelli. A d-tifrir tideţ ma yella d
nekwni nεawen iţ, ma yella ula d nekwni newwi-d tamacahuţ nneɣ
akken tella, mačči akken ţ-bɣan wiyi neɣ akken i
ţ-zewwqen. 3000 iseggwasen aya nekwni d Iskutiyen i ubaɣur n wiyiḍ,
ncennu ccnawi n wiyiḍ, neţmeddiḥ lemdeḥ nsen,
neţwali s wallen nsen. Maca nnuba tura tezzi: ma yella zik neṭtes
mazal lḥal, assa d nekwni i d-isaḥ wawal.
Degmi ilaq a-neţcekkir aṭas deg wid iddmen leqlam iwakken ad aɣ
inin s Tmaziɣt (dagi s Tmaziɣt taqbaylit) tideţ nneɣ deg
umur n lekdeb [wiyiḍ, deg umur n tmucuha iyes daɣ-sedhun acḥal
n leqrun aya ur nuki.
Nessaram adlis agi a t
id-tebεen wiyiḍ ama sɣurneɣ Imaziɣen Izwawen, ama sɣur
Imaziyen illan di Leayer neɣ di tmura nniḍen, icban Merruk, Libya,
Mali, Niger atg. Ladya ungal agi wis-sin
i d-iffɣen s Tmaziɣt taqbaylit. Amezwaru d ASFEL yura Racid Alic.
Di talɣa mxallafen sin wungalen-a, maca ɣurneɣ s Imaziyen abaɣur
yiwen, lmeεna yiwet : la neţaru tamaziɣt, la ţ neqqar.
Ihi tagrayt n wawal d ta: ṭtlam la
yeţeftutus tura d tikli ad ifnu yiḍ, aţaya tfejrit nneɣ!
LMULUD AT MΣEMMER
6°) Préface à « Inna-as Ccix Muḥend »
Avertissement
Jai recueilli ici tout ce qui, parmi les dits et les actes du Cheikh
Mohand Ou Lhocine, est arrivé à ma connaissance, soit dans le discours
ordinaire, soit parce que je lai délibérément provoqué. La somme est
certainement loin en deçà de la masse entière de ce qua dit le Cheikh, mais
elle représente à peu près tout ce qui reste de lui à lheure actuelle.
Jai essayé dans lintroduction de situer le Cheikh à la
fois dans la société kabyle et algérienne où il a paru et dans un plan plus
général. On peut contester tout ou partie des conclusions que jai cru pouvoir
tirer ou, plus positivement, en proposer dautres. Jai pour ma part choisi de
privilégier ce qui, dans la pensée du Cheikh, était novateur, parce que je
pense que cest ce qui est le plus important.
Pour des raisons sociologiques, sur lesquelles je ne puis
métendre ici, cest juste le point de vue inverse que la société kabyle a
adopté pour elle le Cheikh est à la fois hyperboliquement et exclusivement, le
symbole (il faudrait dire le champion) des valeurs anciennes, constitutives de
cette espèce dordre enchanté que constitue à ses yeux la vie traditionnelle.
La pratique cependant dément ce discours, en réalité plus idéologique
quénonciatif : dautres Cheikhs ont vécu, certains aussi célèbres que lui ;
aucun deux, y compris Cheikh Aheddad, na exercé la même action. Celui qui
plus que tous pourrait être son énule, Mhand Ou Saadoun, a été un aussi grand
poète ; son oeuvre ni son action confinées dans le domaine de la pratique
extatique de la religion, nont eu leffet libérateur quont ressenti, plus
peut-être que clairement pensé, les contemporains de Mohand Ou Lhocine.
De toute manière la meilleure façon de ne pas trahir la
pensée du Cheikh était de rapporter le plus fidèlement le plus grand nombre
dactes et de vers de lui. Cest ce que jai tâché de faire. Je nignore pas la
marge, quelquefois qui peut demeurer entre la vérité (sil y en a seulement une
dans ce genre dexpérience) et les versions quen donnent des hommes engagés
dans lépais de lexistence. Aussi ai-je cherché dans la fidélité littérale une
garantie, sans doute pas totale mais tout de même non négligeable,
dauthenticité.
Jai
délibérément multiplié les faits, les noms, quelquefois les dates, tous les
détails précis, qui peuvent paraître inutiles
et ne le sont pas. La nature
même de lentreprise le dictait. Le Cheikh (et moi avec lui) avions besoin de
ce rets de mailles menues pour ne pas nous échapper entièrement au travers ;
ces liens lilluputiens avaient pour effet, et en tout cas pour intention, de
river à la terre des esprits sans cela tentés de décoller sur les ailes de leur
passion. Passionné, le Cheikh létait des contrées lointaines et entrevues
quil tentait de recréer par le Verbe ; je létais par contagion de sa passion
démiurgique. Brise, dira un jour le Cheikh :
Brise, porte le salut
Au saint de colère hanté
Son coeur est bain lustral
Ses yeux lisent dans les signes. . (n°56)
Il est sans doute nécessaire dimposer au délire les béquilles de lordre, afin
de le rendre perméable à notre raison mesurée - mais il faut savoir que, ce
faisant, on se ferme à lessentiel, si lessentiel ne faisait de partout crever
la camisole de force qui nentrave que celui qui ahane à ladministrer.
Dans le détail des épisodes jai tâché de garder autant
quil était possible les caractères de loralité, qui fut le seul mode
dexpression de la pensée du Cheikh. Dans la présentation de lensemble jai dû
me conformer aux règles de lécrit, qui exige des suites ordonnées. Jai donc
adopté un double ordonnancement : chronologique pour la distribution en quatre
grandes parties, grosso modo logique à lintérieur de chacune delles.
Ceci explique le caractère non uniforme de la langue
utilisée dans le texte. Jai naturellement reproduit littéralement les vers,
cest-à-dire tels quon me les a dictés, ce qui ne veut pas dire nécessairement
tels que le Cheikh les a dits. Jai aussi tâché de respecter dans les dialogues
la langue réellement parlée par les locuteurs.
Par contre, dans le texte qui est de moi, jai dû opérer
quelques options et introduire des modifications mineures. Jai autant que
possible réduit le nombre des néologismes, sauf dans lintroduction qui, plus
théorique, nécessitait quelques termes abstraits difficilement évitables.
Cependant, pour deux mots courants: mais et parce que, jai opté pour deux
termes berbères (maca et acku) à la place de walakin et laxater
dorigine arabe, communémént employés en kabyle, mais manifestement mal
accordés au reste de la langue.
Il mest naturellement impossible de citer les noms de
tous ceux qui, depuis plus de quarante ans, ont contribué à produire ces
textes. Les dits du Cheikh et ses actes font partie du discours courant et la
difficulté est plutôt dans la nécessité dopérer un tri dans la somme,
certainement surévaluée, de ceux quon lui attribue. Il me peine de passer sous
silence la masse anonyme de ceux qui, sachant mon projet, sont venus
spontanément me proposer ce quils savaient, avec un zèle, souvent une ferveur,
quil me plaît de rappeler. Ceux dont je vais citer les noms sont ici à titre
indicatif et pour représenter tous les autres :
Salem At Maammer, mon père, ma le premier initié aux dits du Cheikh,
avant même que je sois en âge et en état den saisir la portée ou même le sens.
Djafer et Omar Aït-Ahmed, arrière-petits-enfants
de la soeur du Cheikh, ont pieusement transcrit des pièces arrivées à leur
connaissance.
Mahiddine Oussedik a eu la chance de
recueillir des vers de la bouche dun des adeptes les plus fervents du Cheikh :
Belqasem At Aïsa dAït Hichem.
Boualem Rabia, le plus jeune de tous, a apporté zèle et compétence à
recueillir des dits du Cheikh.
Hadj Saleh At Lmeffeq dAït-Zellal (mort en
1986 à plus de quatre-vingts ans) a été un des derniers à retenir et redire les
dits du Cheikh.
Si Amer Mehanna a dès son enfance été
initié à lenseignement du Cheikh.
Hadj
Hanafi dArous (soixante ans en 1986) a consacré toute une vie à apprendre
et psalmodier quantité de vers religieux, parmi lesquels des vers du Cheikh.
Ahmed
Kerbal ne se consolait pas davoir perdu le manuscrit que son grand-oncle, Sidi
Lhocine, maître décole chez le Cheikh, avait constitué au jour le jour au
cours de sa longue et quotidienne fréquentation du maître.
Mohand
Amezian lheddaden dIsendelen, dont le père fut un fervent adepte du
Cheikh.
Arab
Mohand Zin qui a interrogé les derniers vieillards qui gardaient le
souvenir du Cheikh.
Je nai fait que transcrire ce que la mémoire de tous a gardé. Sans eux la
mémoire du Cheikh fût allée sestompant à mesure que les ans passeraient,
jusquau jour où il ne fût resté de lui quun nom prestigieux et vide, qui
lui-même se fût un jour éteint. Jaime à croire quils ont permis à une grande
pensée de prolonger ses effets par-delà lespace mesuré où il lui fut donné de
sexprimer.
TAZWART
Deg-gwedlis yura Σebderrahman Ibn Xaldun ɣef umezruy lmaziɣen(*) mi yeweḍ ad immeslay ɣef Izennaten
yenna belli εez1en iman-nsen di temɣwer n yiman-nsen, ur asen gin
ara leḥsab iɣerfan(*) nniḍen, sqiṭiεen-d i yemsufar iţεeddayen deg tmura
nsen, u teddun dayem ileɣ
deg ufus. Maca imennuɣen nsen nitni
d iɣerfan i sen d-izzin neɣ nitin d igeldan trn
ijuwwren, ur ten urin ara. » Yerna Ibn Xaldun yenna belli ssebba n westehzi-yagi d-tik1i telḥa
taεrabt garasen wala čer igeldan nniḍen, ue
sḥersen deg imyura iwakken ad arun
amezruy nsen, armi aḥric
ameqqwran deg-s yeɣli. Ula mi sbedden tigeldiwin(*), ala kra l-lexbar l-lexyai i d-ṭtfen seg-sen.
Taggara yenna Ibn Xaldun belli d
lexbarat nni iɣef ţnadin imezrayen(*) di mkul mkan ; assεad nsen
ma ufan lǧerra nsen iwakken a-ten-id-sukksen si ttlam deg meḍlen
ar tafat deg ara ten-wanin akw medden.
Tin iḍran d Izennaten teḍra
d Imaziɣn akw seg asmi yebda umezruy nsen, mi d-kecmen
Yefniqen(*) tamurt nsen di lqern tnac qbel Σisa. Kra nnan d kra xedmen lmaziɣen zik ur- t-iẓra ḥed, acku ḥed ur t-yuri. Ayen akw i d-ţawin imezwura nneɣ illa
kan s tmenna mačči s
tira, armi kra ijla yaɣ(*)
i nekwni d-irnan deffirsen.
Amezwaru d-ibedren Imaziɣen deg umezuy d amezray agrigi Iṛudut
di lqern xemsa qbel Σisa. Seg-assen armi d lweqt deg yura Ibn Xaldun εeddan εacrin
l-leqrun ; di εacrin l-leqrun agi acḥal i iεddan n yergazen
xedmen, nnan, snulfan, wwin-d ayen d-wwin maca ur d-iqqim seg-s wacemma, acku ur t-yuri ḥed. Wid yuran
di zzman nni uran s tmeslayin tiberraniyin yellan leḥḥunt imiren : di zzman n Rum s-tlatinit
i-yuran Tertulyan Kiperyan, Awgugtin, Frunṭu, Arnub, Apulay, yili deg idlisen nsen llan
ţbut n timmazeɣt(*) deg d-kkren ; d amedya(*) Apulay deg yiwen wedlis
ines yeḥka-d tadyant n Fsica(*) u tadyant-a mazal-iţ ar
assa sawalen-ţ-id deg yiwet tmacahuţ teţwassen, qqaren-as Σaṣfur-u-Lehwa.
Seg assen s assa, ur tbeddel ara liḥala ɣef Tmaziɣt. Di
tmura yakw deg ţmeslayen tamaziɣt, icban Merruk, Lezzayer, Tunes, Libya, mebla εad ma
ibeder-d yiwen timura
iberkanen am Mali d Niger, ţsemsetbaεen imnekcamen (*), wa irennu
taluft-is i tin d-yeǧǧa win i d-izwaren Tamaziɣt
dayem teqqim berra n wennar. Amezruy
nneɣ yebda telt alaf iseggwasen aya (mebla ma yeḥseb bnadem leqrun uzaramezruy (*) ; di telt alaf iseggwasen agi uran
medden.(lberrani wala Imaziɣen) s tefniqt, s tlatinit, s tegrigit, s teεrabt, s tefransist,
yiwen ur yuri s tmaziɣt, armi teqqim tmeslayt nnepq tḍaε, ayen daɣ iruḥen di lweqt nni yakw ur isεa ara azal, am
akken inna Ibn Xaldun s
yiman-is, yellan yeţaru s taţrabt.
D taluft-a taqdimt i ilaq ad nemḥu
tura ; ilaq-aɣ ad
nesemneε ayen akw iwimi nezmer deg ayen daɣ d-iqqimen seg idles
nneɣ skud ur iruḥ ula d neţa. Imaɣlayen(*) umezruy n zik
keblen ifassen i imezwura nneɣ
wid umezruy n wassa ur
εdilen ara.
Amezruy n wassa ixulef di snat temsal,
yiwet tenfeε tayeḍ tḍur.
Tin iḍurren tazmert n ddulat n zik d tin n ddulat n tura mxallafent. Tazmert n ddula n zik nni ur tzad ara; ma tella teqbilt illan teqwa cwiṭ, tezmer a-ţ-tqamer(*) neɣ xersum a-s-tjaneb, ad tali s adrar (akken xedmen
Leqbayel d Icawiyen), neɣ ad tɣerreq di Ssehra (akken xedmen Imucaɣ, Imzabiyen d kra Izennaten). Seg asmi d-snulfan Irumyen yal asafar,
uɣalent ddulat n wassa nnernant di tezmert ; ulac tamnaṭ
ur wwident ara s tamubilat, s isufag, s radyu, s iɣerbazen(*).
Aɣerbaz ladɣa iɣelb-itent
akw. Skud meẓzi weqcic
aqerru-s fessus, irḍeb am rekwti,
akken tebɣiḍ a bnadem
ad t-tεerkeḍ. M ara yuyal d argaz ad t-id-yaf Iḥal iqqur kan ɣef ayen ibfeḍ di temẓi-s,
d ayen kan iwimi ara d-iţεawad, d tameslayt ilmed
assen ara d-izeggwiren s iles-is.
Maca tella tayeḍ
tenfeε deg umezruy n wassa.
Di lqern εecrin agi deg nella telḥa tussna, armi
tuɣal tezmert-is tekka-d nnig
tezmar nniḍen akw u
annect-a di mkul amḍiq. Ihi yezmer bnadem ad issexdem allalen-is. Assa win
ibɣan ad d-yesuffeɣ idlisen s
tmeslayt i s-ihwan, ama tewaru zik ama ala, acku tussna tesukkes-d leqwanen
n tmeslayt wala wid n tira. Assa nezmer ad d-nesuffeɣ idlisen di mkul
ssenf.
Maca axxam ibennu ɣef llsas. Llsas nneɣ nekwni d ayen nnan d wayen gan
imezwura nneɣ. D win i daɣ
iiaq ad d-nejmeε assa. Tagi d yiwet di ssebbat n wedlis-a ɣef Ccix
Muḥend. Llant tiyaḍ, acku ayen inna Ccix mačči kan ala
Leqbayel neɣ ala Imaziɣen i yeεna. Asekkud-is iffel i tlisa n tmutt n Leqbayel, ulamma din i d-yennulfa, yeεna akw timura d akw lewqat.
Tahrayt(*) n wawal, awerrat iḥerzen ayen das d-ikkan sɣur iwaldin-is, yelha;
Win irnan s ayen i s-d-iǧǧa baba-s, yif-it. Ihi ayen d-nejmeε si
tmussni n Ccix ad aɣ yili d llsas iɣef ara nebnu, ad
nesiţeε am akken isiţeε
tin n yigad t-izwaren.
AWALEN
(*) :
1. Ibn Khaldoun - Histoire des Berbères et des dynasties musulmanes de lAfrique septentrionale, De Slane,
Paris, Geuthner 1925, Tone
III, pp. 305-306.
2. Aɣref (Iɣerfan) Peuple,
3. Tagelda (tigeldiim) Royaume,
4. Amezray (imezrayen) : Historien,
5. Afniq (ifniqen):
Phénicien,
6. jlu (ijla-ur ijli-ijellu) : Perdre.
7. Timmazeɣt : La berbérité.
8. Amedya (imedyaten) : Exemple.
9. Fsyca : Psyché.
10. Anekcam (inekcamen) : Envahisseur.
11.Azarmezruy : La préhistoire.
12. Amaɣlay (imaɣlayen) :
Circonstance.
13. Qamer (iqumer, iqamar, aqamer) : Résister, sopposer à.
14. Aɣerbaz (iɣerbazen)
: Ecole.
15. Tahrayt (tihrayin) : Conclusion.
Numéro 74 Février 2015
L interview :
Mouloud Mammeri,
Entretien avec Tahar Djaout :
La Cité du soleil (inédit de Mouloud Mammeri), Alger Laphomic. 1987 (Extrait pages 1 à 9)
1- UN TEMPS DE TEMPETES
- Est-ce
que je peux commencer de façon abrupte ?
- Cela va nous
éviter les précautions oratoires
- Ton
premier roman a paru en 1952. Nous sommes en 1986. Quand tu regardes en arrière
ces trente-quatre années passées, qu'est-ce que ça te fait ?
- Je me dis que
je suis venu à un moment passionnant, mais peut-être pas toujours facile.
-
Pourquoi `?
- Parce que les
périodes de transition comme celle que nous venons de vivre et qui dail1eurs
continue... enfin sous dautres formes... cest tout xi fait exceptionnel dans
une vie... mais ça donne un peu le vertige... je sais bien que cest le cas de
beaucoup de pays au monde... et que cest un peu la marque de notre temps...
- La
pose de lintellectuel assis, bardé de certitudes et de bonne conscience, de
superbe aussi quelquefois... souvent... ça te tenterait ?
- Pour rien au
monde I Linquiétude, ce nest peut-être pas une situation très confortable,
mais... cest peut-être aussi une question de tempérament." Je pense qui1
nest pas possible en 1986- dêtre assis, certain, superbe ; et le tout avec
bonne conscience. Parce quen 1986, le vertige. Cest aussi celui des
certitudes et des idéologies... Les hommes en font depuis quelques années une
consommation effrénée jamais ils nont eu à choisir entre tant de formules diverses,
contradictoires, mutuellement exclusives...
- C'est
un bien, non ?
- Cest sûr, si
la liberté du choix était réelle, mais tu sais bien quil n`en est rien. Les
formules les plus oppressives, les plus manifestement tyranniques, sont celles
qui crient le plus à la liberté... sans doute pour que la hauteur du cri
compense la faiblesse de largument ou la couvre. En cette fin de siècle de
foisonnement idéologique, cc quon attendrait, c`est une mutuelle tolérance des
chapelles qui toutes cherchent à nous enrôler... Cest le contraire qui se
produit. Chaque église clame haut... haut et court, si j`ose dire, quelle a le
monopole de la vérité. Chacune est prête à bruler tout ce qui ne pense pas, ne
vit pas, ne rêve pas comme elle... sans jamais s`aviser qu`il faut une sacrée
dose d`assurance pour oser croire et proclamer que lon est seul à avoir
raison, que des centaines de millions dh0mmes croupissent dans lerreur...
parce quils pensent différemment.
- Nous
voilà loin de la littérature !
- Pas tellement,
parce que... cest une vérité banale, mais certaines banalités sont aussi
bonnes à dire... parce que si la littérature nétait que de lenfilage de
façons de dire... sans rien derrière... ou au-dessous... il y a beau temps que
les hommes auraient cessé d`en faire.
- C'est
un problème trop capital pour que nous le traitions ici dentrée de jeu, à la
va-vite... Nous allons sans doute revenir dessus plus tard.
-
Certainement ! Ce que j`en disai35s, c`est pour répondre à ta question...
parce que je crois que ce qui caractérise cette seconde moitié du vingtième
siècle, cest en regard dune histoire agitée, une égale agitation des
croyances... Pour beaucoup dhommes et de femmes de ma génération, cest une
donnée capitale. Personnellement, je suis né à la fin lune guerre mondiale...
la première du genre... qui devait être la dernière... Quand la seconde est
arrivée... vingt ans après, comme dans les romans..., jétais juste en âge dy
prendre part... Pendant quatre ans, jai bourlingué dans quelques coins dAfrique
et dEurope ou des hommes tuaient... ou mouraient... pour des causes
apparemment aussi saintes... ct évidentes... dun côté que de lautre... Tu
vois quon nest pas tellement loin de ce que nous disions tout à lheure... En
ce qui me concerne, la cause pour laquelle jétais censé me battre, mémé si le
choix navait pas été mien dès le départ, était dans labstrait très claire.
Dun côté la liberté, la démocratie... de lautre le totalitarisme,
loppression...
Quelques jours
avant ma démobilisation, nous étions en Allemagne... je voyais les officiers -
français - de mon bataillon conciliabuler et se taire dès que japprochais.
Quelques jours plus tard, japprenais que le 8 mai, du côté de Kherrata,
Sétif... Le 8 mai, cétait le jour même de la victoire, la victoire de ceux qui
défendaient la liberté, la démocratie etc...
Cela voulait
dire que la deuxième guerre mondiale risquait fort de nêtre pas la dernière
elle non plus. Cela ne pouvait pas rater. Il a fallu moins de dix ans cette
fois. En novembre 54, javais trente-sept ans ; jen aurai quarante-quatre
quand la Guerre de Libération prendra fin. Ce qui sest passé depuis intéresse
tous les Algériens et il nest pas nécessaire que je le rappelle ici.
- Est-ce
que, si tu avais le choix, tu changerais dépoque ... Une époque avant pourquoi pas... après ?
- Non, ni lun
ni lautre. Ce nest pas seulement parce que cest une hypothèse gratuite et
qui1 ne sert à rien de se demander ce que le monde serait... je ne sais pas...
si Napoléon navait pas existé... si Carthage lavait emporté sur Rome... si
les Musulmans navaient pas été chassés dEspagne. Non, seulement je trouve
lépoque qui a précédé lindépendance passionnante pour un Algérien... malgré
ou peut-être qui sait : à cause de son poids dépreuves. Quand je compare la
situation actuelle avec celle dans laquelle je suis né, avec tout ce qui est
intervenu dans l`interval1e, je pense quaucun roman, aucun drame ne peut en
répercuter lintensité. Je suis né dans un petit village haut perché à lextrême
pointe dune colline de Haute Kabylie. A peu de choses près, la vie que lon y
menait était celle qui sy déroulait depuis des siècles. Nous étions coupés du
monde ; pas de route, pas délectricité, pas de téléphone. Le médecin le plus
proche était à dix-huit kilomètres de chemin de montagne. Mais, fait
remarquable et très exceptionnel, il y avait une école, de celles que la
Troisième République française au laïcisme militant faisait construire, pour
faire pièce : à lécole des cures.
- Dans
le panorama général, c'était une pièce rare.
- Cest vrai...
une exception mais, sans cette exception, qui sait ce que les milliers délèves
qui en sont sortis (elle date de 1883, je crois, lépoque héroïque de lécole
laïque), qui sait ce que ces milliers délèves auraient vécu. Lécole, cétait,
au moins au début... notre seule fenêtre sur le monde. Les vitres, je lavoue,
étaient plutôt des prismes déformants... Mais cela, je ne devais lapprendre
que plus tard... et puis de toutes façons, cétait le
prix à payer. Pour lors, la fenêtre faisait vraiment partie de la maison. Elle
était du village elle aussi, plus cossue mais pas tellement différente des
dizaines de petites maisons qui couvraient la colline. Jy allais pieds nus
dans la neige. Nous y jouions aux jeux de nos ainés. Le vieux directeur parlait
berbère comme nous, ses enfants aussi. On ma souvent demandé pourquoi j`avais
donné à mon premier roman ce titre apparemment contradictoire... tout le texte
semble le démentir. (Test que javais dans l`esprit l'image du village réel qui
mavait servi de prétexte... un village oublieux du monde, mais aussi oublié de
lui. Javais onze ans quand jai quitté le village jamais réellement oublié de
mon enfance. Et à ce moment ma chance -je crois que cest le mot quil faut -
ma chance a été quau lieu daller, comme tous mes autres camarades, dans une
des villes coloniales du reste de lAlgérie... des villes sans âme, des villes
sans art... pour ce que je connais delles... jaille au Maroc... le Maroc des
années trente... ou des hommes se battaient encore pour leur liberté... la
dernière tribu indépendante ne devait déposer les armes que quatre ans après
mon arrivée. Rabat ou je parvenais était encore une vieille ville, toute
pénétrée de nostalgique Andalousie, une ville oubliée elle aussi... lhistoire
du Maroc pendant des siècles sétait faite à Fès ou Marrakech, un peu Meknès...
Oubliée, mais si vraie, si attachante que les éraflures de la modernité sur ses
franges tachaient de reproduire, au moins en surface, les incantations d`une
médina sereine, lente, lovée sur le cur delle-même, feutrée.
Tous mes
camarades de « La Colline Oubliée » sautaient brusquement dun passe
de gestes et de pensées immémoriaux au vingtième siècle le plus décapé, celui
des laids villages coloniaux. A moi, on ménageait la grâce dun intermède, une
parenthèse de moyen-âge à peine effleuré de modernité. Le lycée ou jétais
était celui des fils de fonctionnaires et de colons français. Comme
« indigènes », il yavait deux Marocains et moi.
Jai passé quatre
ans à Rabat, avant de venir au lycée dAlger et, tout de suite, jai vu que je
changeais de galaxie. Cétait mon premier contact avec un monde qui ne fait pas
celui des villages oubliés ou bien des cités médiévales, le monde dune
colonisation sans fards. Celle du Maroc était fardée justement. On faisait
semblant dy respecter les formes dans une société qui en était bourrée
jusque-là. En Algérie on jouait, comme les morts au bridge," toutes caries
étalées.
- Tu ne
crois pas que, de toutes façons, la réglé du jeu était la mémé quant au fond...
malgré le théâtre...?
- Certainement,
mais à lâge ou jétais, les jeux de la scène pouvaient encore faire illusion.
Cest plus tard que jai appris quil y avait une loi du système, impérative
malgré les fantasmagories de la mise en scène.
- Le jeu
a du être encore plus clair à lUniversité. Vous étiez combien
d « Indigènes » si la Fac dAlger ?
- Après le
bachot, je nai pas été à la Fac dAlger. A lépoque de bonnes Humanités
(jétais un littéraire) se parfaisaient en France. Jy allai... Cest là que
lautre guerre m`a surpris... la deuxième mondiale... Tout de suite propulsé
dans la grande histoire... Le Maroc, lItalie, la France, lAllemagne... Et
puis la victoire... pour les autres... et pour nous le commencement de la
Longue Marche Comment veux-tu que je désire changer dépoque ?
2/-
ECRIRE... POUROUOI ?
(Du tuf
ancestral aux lendemains de fête)
La
dernière fois, cest surtout de l'époque que nous avons parlé... ou plutôt de
ton itinéraire dedans...
Cest, pour
lessentiel, celui de beaucoup dhommes de ma génération.
- Mais
la littérature, c'est dabord des livres. Parlons dabord quantité : je trouve
quen trente-trois ans, cest la durée classique dune génération dans les
livres dhistoire... je trouve quen trente-trois ans, tu nen as pas fait
paraitre beaucoup.
- Je trouve
aussi. Quatre romans, deux pièces de théâtre, autres nouvelles, deux petits
recueils de contes, ce nest pas la masse, mais javoue que personnellement,
cela ne me gène pas beaucoup.
- Il y a
donc des raisons... peut-être des raisons objectives.
- Deux à mon
sens : une dordre matériel et pour ainsi dire circonstancielle, une autre plus
essentielle, parce quelle tient à lidée que lon se fait, ou en tout cas que
je me fais de la littérature.
-
Commençons par lépisodique.
Oui. On croit
quelquefois que la production dun livre se passe dans un espace éthéré,
détaché de toute condition dordre matériel. On écrit un livre, un éditeur le
publie, des lecteurs le lisent el, s`il est bon, il a du succès. Cest ce que
jai cru moi-même en entrant en littérature et aujourdhui encore je ne suis
pas sûr davoir absolument abandonné cette illusion. Peut-être cette vue
est-elle vraie sur le long terme et quau cours du temps une sorte de décantation
se produit. Ce nest mémé pas couru davance : pourquoi par exemple rien
nest-il resté des écrits moatazilites ?
En tout cas,
dans le court terme, lédition dun livre est soumise à beaucoup de
conditions qui quelquefois nont qu`un rapport très indirect avec la
littérature, et cela était particulièrement vrai pour nous, qui avons écrit...
ou plutôt, qui avons publié... au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale.
Réduit ai sa vérité nue, la situation était la suivante : un écrivain écrit
pour un public, mais de par sa condition, lécrivain algérien était dans
létrange état dêtre un écrivain sans public. Car, sil dit la vie algérienne,
qui le lira ? Les Algériens, quils soient berbérophones ou arabophones, ne
savent pas lire, du moins dans leur écrasante majorité. Les Européens, quils
soient de France ou d`Algérie, étaient dune façon générale peu préparés, c`est
un euphémisme, de lire un livre sur eux-mêmes par ceux quon appelait
« l.es Indigènes » : les mieux intentionnés étaient prêts à jeter sur
nos uvres une condescendante sollicitude ; el, de toutes façons,
professionnels ou pas, ils étaient le petit, le tout petit nombre.
Il ny avait pas
déditeur algérien ; il ny avait même pas déditeur du tout en Algérie. Une
expérience comme celle de Charlot devait beaucoup à létat de guerre ou lon se
trouvait alors, et, de toutes façons, Chariot éditait pour le même public,
massivement européen et, par la force des choses, davance déterminé : quelles
que fussent ses intentions... et elles étaient bonnes... il ne pouvait pas
ignorer absolument les conditions du marché.
C`est dire que,
pour un écrivain algérien des années cinquante, lentreprise d`écrire était un
peu une aventure A fonds perdus. Quoi quil puisse paraitre au premier abord,
cet état nétait ni porteur de virtualités infinies ni non plus indiffèrent. Ce
nest pas tout à fait une situation en porte-à-faux, mais écrire pour
linte1ligentsia de Saint-Germain-des-Prés, le Saint-Germain de laprès-guerre,
ou bien pour le public gauchisant de lépoque supposait aussi des servitudes
et, quelles fussent le plus souvent inconscientes, ne les supprime pas : on ne
vise pas tout à fait impunément un type de public précis.
Les conditions
ont changé depuis, mais justement grâce en partie à lémergence de cette
littérature maghrébine des années cinquante... maghrébine, parce quà peu près
à la même époque, elle a aussi commencé de se manifester au Maroc et en
Tunisie... Aujourdhui, le fait même d`une littérature maghrébine écrite en
français ne fait plus problème.
Cest dire que
dans lintervalle, il sest constitué ai la fois un public et une édition. Ceci
pour dire que létrange condition dont je parlais tout ai l`heure, celle dun
écrivain sans public (je parle dun public naturel), une condition faite de
plusieurs contradictions accolées, nest pas de celles qui induisent une
production abondante.
Entendons-nous
bien. Ce nest pas quil soit toujours impossible, de produire beaucoup, quand
on est dans cette condition. On a des exemples nombreux décrivains africains
ou asiatiques qui ont abondamment écrit en anglais, en français, en portugais ;
simplement ils s`insèrent alors dans une pratique ou leur qualité de Nigérian,
dIndou ou de Libanais nest plus quun accident.
Sil en allait
différemment pour nous, cest, je crois, parce que ce nétait pas seulement
dun événement littéraire quil sagissait, le fait de gagner de vieilles
littératures très assises des domaines (ou des modes) nouveaux dexpression.
Sil sagissait
de faire entrer la vie des hommes algériens dans le commun lot des autres vies.
Et cela nallait pas du tout de soi ; parce que cette proposition, qui a
auj0urdhui lair dune évidence, prenait lexact contre-pied de celle qui
avait cours. Il y avait, dans la littérature, une image de ce qu`on appelait
« l`Arabe » ou « lIndigène », une image tellement rebattue
quil ne venait à lidée de performe quelle doit être autre. En schématisant
un peu, on peut dire que les Algériens étaient, dans le meilleur des cas, des
éléments du décor, et, dans le pire, des modèles conventionnels et toujours
péjorés. Ou la carte en couleurs pour touristes en mal dexotisme, ou
lartefact raciste et freudien.
Aux écrivains
denvergure internationale et né en Algérie, on a fait le reproche de navoir introduit
dAlgérien quune fois dans son uvre et sous lespèce dun étrange et
dangereux manieur de couteau. Je crois que cest un mauvais procès. Sur le plan
de l`éthique - ou de lidéologie - il est évidemment justifié ; sur le plan
littéraire, il est sans fondement. La réalité algérienne était ce quelle
était, la travestir sous prétexte de vertu politique, cétait la trahir. Les
deux communautés qui constituaient la société algérienne de lépoque étaient
parfaitement étrangères lune à lautre. Jentends quant au fond. Le rapport
colonial est un rapport dexclusion réciproque par définition.
Pour un Européen
dAlgérie (ceux quon nappelait pas encore les Pieds-Noirs),un
Algérien navait, si jose dire pas dexistence pleine. Cétait un modèle
vaguement fantasmatique : quelques fonctions (la vigne, le parquet, le régiment
de Tirailleurs) ; quelques schémas rapides (ils sont tous ceci, cela...), un
vague fond de peur, quon tachait de traduire en mépris pour le rendre
supportable - et en voilà pour toute la vie. Dans la société coloniale, ce
nest pas un individu, ce sont tous les Algériens qui sont étrangers, plus
étrangers que le plus étranger des Pieds-Noirs.
Un jugement
littéraire est par nécessité relatif ; je veux dire quil est rapporté à des
conditions, à un temps précis. C`était à une mutation de statut quil fallait
procéder, quand on écrivait dans les années cinquante, et on ne peut pas, je
crois, porter un jugement droit sur les (uvres qui ont paru alors, si l`on na
pas en lesprit tout le poids de préjugés qui1 fallait desceller. Il ny a
quà imaginer la réaction... éberluée, ravie, suffoquée, rétive... de ceux qui
nous lisaient alors avec les yeux de leurs habitudes : Hé quoi ! Ils (cet ils)
ils rient, ils pleurent, ils aiment, ils hurlent et ils rêvent comme tout le
monde... comme nous ! Ce nétait plus une surprise, cétait un scandale !
-
Pourtant, je crois me rappeler que tous les romans algériens qui ont paru vers
ces années-là ont obtenu des prix... Le grand prix de la ville dAlger pour
« Le Fils du Pauvre », le prix des quatre jurys pour « La
Colline oubliée », le prix Fénélon pour « La Grande Maison », le
prix populiste pour « La Terre et le Sang »...
- C`est la
meilleure preuve quon les marginalisait. Nous disions... nous nous disions, en
français". Quel que fut le résultat, il fallait récompenser cette bonne
volonté... Cétait du paternalisme inconscient, par ailleurs très bien
intentionné.
- Voilà
pour la raison épisodique... mais tu disais quil y en avait une autre plus
essentielle.
- Oui, une
raison qui tient à lidée que je me fais (ou que quiconque peut se faire) de la
littérature. Pour moi, la littérature nest pas un métier, en tout cas, pas un
métier comme tous les autres.
-
Comment cela ?
- Je
pense, peut-être un peu naïvement... que lon écrit quand on a quelque chose à
dire. Ca a l'air d'aller de soi. Mais je ne sais pas si cela épuise le
problème... Tout le monde a quelque chose à dire.
- Cest vrai,
mais dune part, on ne dit pas nimporte quoi et d`autre part, on ne le dit pas
n`importe comment. Mais au moment où je dis ceci, je m'aperçois que cela peut
prêter à équivoque. Alors si tu veux, je vais préciser ça. Quand je dis : on ne
dit pas nimporte quoi, cela ne veut pas dire quil y a des sujets plus
prestigieux ou plus louables que dautres. La Guerre de Libération a été une
épopée tout à fait remarquable, mais croire quon ne peut écrire un roman sans
quelle en soit le sujet, cest se tromper. La valeur vraie dun livre ne se
confond pas avec les valeurs, elles de convention, des événements quil relate
et redire un héros ne rend pas plus héroïque la narration.
Les exemples
sont évidemment innombrables, dans les deux sens. Le récit des faits et gestes,
des mots et des fantasmes dune petite classe daristocrates désuvrés peut paraitre une entreprise dc très modeste portée : à quoi
bon aller à la recherche du Temps Perdu en si maigre équipage ? Mais quune
sensibilité, une intelligence particulière sen emparent pour, à travers lui,
dire tous les hommes, mieux que ne le fruit jamais la plus minutieuse, la plus
exhaustive des descriptions, et soudain tout flambe, tout soudain change de
nature. Ce n`est pas le petit monde de Guermantes (appelé grand par plaisant
euphémisme) que Proust dit ; cest quelque chose de beaucoup plus essentiel.
Si le sujet est
indiffèrent... même là je pense quil faudrait nuancer, mais nous n`avons pas
le temps... la manière de le dire, elle, ne l`est pas, je crois même que le
nud de la question est là : dans le rapport, toujours unique, imprévisible,
quun livre établit entre ce quil dit et la manière dont il le dit. La manière
dc dire, il en est même qui ont fait d`elle l`essence de la littérature... des
écoles entières, je crois, peut-être davantage en poésie, mais aussi pour la
prose... des écoles... et naturellement aussi des individus. Une formule
extrême a consisté à voir dans l`orfèvrerie de la forme la vocation même de
tout acte de littérature. Un de mes amis, poète a ses
heures, disait plaisamment : il y a des gens qui nont rien à dire, mais qui le
disent très bien.
Sans aller
jusquà ces paradoxes de la boutade, il est évident, je crois, qui1 n`y a pas
de littérature s`il n`y a pas souci de ce que les manuels de mon enfance
appelaient : la forme. Le problème réel est : quel rôle exactement est le sien
« Simple instrument, une Sorte de faire-valoir ? Ou but en soi ? »
- Je ne
crois pas qua cette question on puisse répondre de
façon univoque, par oui ou par non.
- Je ne crois
pas non plus. Les deux choses sont probablement si intimement mêlées, si
fondues lune dans lautre (comme on dit chez nous : am-maman deg-gwaman,
(comme leau dans l`eau) que vouloir établir une distinction entre-elles
devient pur exercice décole.
Mais peut-être
que les réponses quon apporte à la question déterminent des comportements
différents chez les écrivains ?
- Tu
veux dire des styles différents
- Pas seulement,
mais des comportements différents. Si lon croit quil ne faut écrire que quand
on a vraiment quelque chose à dire, on sexpose ai déventuelles longues
traversées du désert. Est-ce vraiment un mal ? Racine a cessé décrire à
trente-huit ans. Quand, douze ans plus tard, les circonstances lont obligé à
revenir au théâtre, deux pièces en deux ans ont montré quil n`avait rien perdu
de son génie... Deux ans. Deux pièces, après quoi, il se taira jusquà sa mort.
_Je cite ce cas seulement a litre d`exemple.
-
Toi-même ?
- Entre mon
premier et mon dernier roman « La colline Oubliée » et « La
Traversée », il s'est écoulé trente ans. Dans lintervalle, jai publié
quatre romans, deux pièces de théâtre, quatre nouvelles, mais je pense que
chacun de ces uvres a correspondu à une réelle sollicitation, quelque chose
comme une réponse ai un appel.
Il est certain
que le tempérament joue ici un grand rôle. Dans la forêt soudanaise, un
battement de tambour est un message ; il peut être modulé, mais dabord il
signifie. Mais aussi pourquoi, pour le simple plaisir, un soir dété, une main
fiévreuse ne battrait-elle pas à le rompre un tambour vain ?
- Jai
l'impression quen ce moment tu fais de la littérature justement.
- Cest vrai,
mais jespéré qui1 ny a pas que cela derrière ces tambours tropicaux.
Jespère que derrière la maniéré de dire, il y a aussi du dire. Ce que je
voulais dire, cest que les hommes ne sont vraiment prêts à lire (et en tout
cas ai retenir) que le Verbe qui, dune façon ou dune autre, éveille en eux
des résonnances. Il faut quils se retrouvent dans ce quils lisent, quils se
retrouvent au plus vrai, quils découvrent des vérités enfuies peut-être au
plus profond deux-mêmes. Le lecteur vous sait gré de lire en lui, mais, si les
mots que vous lui proposez sont pure presdigitation, il admire et... oublie.
- Mais
ne penses-tu pas aussi qu'il sagit la Presque dune conception réductrice et
utilitaire de la littérature, contre laquelle on peut facilement plaider ?
- Comment cela ?
- Est-ce
que ce nest pas dune certaine façon ravaler la littérature que de la réduire
à ce rôle dinstrument ? Est-ce quil ny pas aussi une fonction révélation de
la littérature ?
- Sans doute.
- Briser
les moules convenus, pousser la forme jusqu`aux limites de ses possibilités...
de ses impossibilités, la faire en quelque sorte exploser, nest-ce pas une
manière de briser des contraintes et donc daider é la création de quelque
chose dautre ?
- Maintenant,
cest toi qui fais de la littérature.
- Cest
pour tenter de rendre une idée que je crois vraie. En contraignant les mots et
leurs agencements à des usages insolites, on brise des chaines, on habitue les
hommes à prendre avec lordre des choses... lordre, ce vilain mot... des
libertés... la liberté, ce beau mot... et, si je peux encore faire de la
littérature, ai faire concurrence ai Dieu. Je crois que les Grecs avaient un
mot pour cela ; ils disaient : un démiurge. Est-ce quun écrivain nest pas,
dune certaine façon, un démiurge ?
- _le pense que
nous voilé ramenés à notre propos du début. Je pense comme toi que lécrivain
est dabord un créateur... le créateur dun monde plus conforme ai nos
exigences profondes... Dans la mesure où celui que nous vivons nous heurte.
Cela devient une question de définition. Le monde que le poète crée nest
crédible, nest souhaitable, que sil nest pas absolument gratuit, sil garde
avec le monde réel des rapports tels quil emporte notre conviction.
Quelquun, je ne
sais pas exactement qui... a dit quécrire un roman ca consistait a mentir vrai.
- Est-ce
que tu as limpression que c'est ce que tu as fait dans tes romans ?
- je crois. _le
suis né algérien, cest-ai-dire dans un pays colonisé depuis pres dun siécle
et à un moment ou le système semblait installé pour longtemps : la France
sortait victorieuse dune guerre longue. Quand lAlgérie a recouvré son
indépendance, javais quarante-quatre ans. Quoi que je fasse et quoi que je
veuille, tout ce que je dirais ne pouvait s`inscrire que dans ce cadre. Les
quatre romans que j`ai écrits référent chacun à un aspect et comme à une étape
de la vie du peuple algérien durant cette période à la fois décisive et
difficile. « La Colline Oubliée », cest le tuf ancestral, celui sur
lequel tout le reste allait pousser. « Le Sommeil du Juste », cest
le lieu des situations bloquées et qui appellrnt den sortir.
« LOpium
et le Bâton », cest l`épreuve de la libération, et
« La
Traversée », les lendemains de fêtes.
3/-
ENGAGEMENT, ENCAGEMENT ?
(Le
devoir de vérité dans les vases du chott)
- Tu
disais que chacun de tes romans représentait une étape de la vie du peuple
algérien. Est-ce à dire que tu te considères comme un écrivain engagé ?
- Le problème de
lengagement a longtemps occupé la littérature daprès-guerre, je veux dire la
Seconde Guerre Mondiale. (Test donc un problème de ma génération. Il est passé
de mode dans les pays où il est né, mais il continue chez nous de servir à tout
crin, dailleurs plus comme recette que comme source vivante de réflexion.
-
Justement, je voulais savoir ce que tu en penses.
- Dabord quil
doit correspondre à une fonction essentielle, puisquà la suite de ses
inventeurs. Les philosophes
existentialistes, je crois, et surtout Jean Paul Sartre... il a connu une
fortune considérable et pratiquement mondiale. A la fin des années quarante et
dans les années cinquante, il était pratiquement impossible à un intellectuel
de se déterminer que par rapport à lui. LHistoire depuis a marché ; elle a
imposé dautres problèmes, souvent plus urgents... pas partout bien sûr...
-
Justement pourquoi à ton avis cette fidélité plus grande dans certains pays...
le nôtre peut-être...?
- Je crois que
cest un phénomène général pour tous les pays du Tiers Monde... ou un grand
nombre dentre eux, ou la réflexion est souvent, comment dirai-je ?... provinciale
en quelque sorte... sans acception péjorative du terme... Elle y retarde (ou
s`attarde) de plusieurs années, quelquefois de plusieurs décennies, sur celle
des grands centres où on considère, à tort ou à raison, que sélabore une
réflexion plus valable. Chez nous, le phénomène est tellement courant qu`il est
presquinutile dc le mentionner. Je ne sais pas si la réputation des écrivains
algériens de langue arabe se fait au Caire, mais il est sûr que celle des
uvres écrites en français se fait à Paris, et tel écrivain dont lédition
algérienne refuse le roman (entre parenthèses le bon roman) nest reconnu
quaprès que la critique française a fait léloge de son livre, entre temps
publié en France. Je pense qu`il y a là un problème beaucoup plus général.
Parce quil y a une constatation simple, que lon peut faire chaque jour. Ceux
qui, sous prétexte dengagement, crient à lagression idéologique de lOccident
et au néo-colonialisme culturel, ceux qui prônent le plus véhémentement un
retour aux sources... comme si lon pouvait vivre en retournant, ou même
seulement en se retournant,... sont souvent les plus idéologiquement aliénés,
comme si la fureur du cri les rachetait de la dépendance. Ils nont pas assez
maitrisé, assez transcendé les concepts de lOccident pour au besoin sen
détacher, les repenser, les faire vivre ; il en va deux un peu comme ces
voyageurs engages par distraction dans les vases du chott : plus ils font
defforts pour se dégager et plus ils senlisent.
Si bien qu`on
arrive là à un beau paradoxe, La pensée de l0ccident offre elle-même les
instruments de sa propre contestation. Toutes les cultures... peut-être faut-il
dire toutes les idéologies... ne sont pas ainsi faites ; il en est qui sur
elles-mêmes nadmettent... et dai11eurs ne connaissent... quun seul type de
discours : lhosanna et lauto-dithyrambe.
En tout cas,
cest ce qui se passe pour lengagement ; nous l`avons pris à lOccident comme
nous prenons ses usines 1es clefs en mains. Après il ny a plus quà laisser
fonctionné la machine. On a trouvé le sésame. La formule tient lieu de
réflexion, à la limite elle en dispense. Lengagement, ainsi utilisé, nest pas
seulement un instrument commode, cest aussi un bon instrument de terrorisme
intellectuel : il permet de condamner ceux qui pensent différemment.
( à suivre )
Le poème :
Ur t-cqan medden, sɣur Σ.Mezdad, 1989
Ur t-cqan medden ma nnan
neɣ wi yebɣan ad yeseglef
di temẓi-ines yezreɛ urfan
ma d ul yezga d imcennef
di tmurt iɛebbden ɛeryan
d amɣar icab iwellef
Nnan-as tirẓaganin
mi ur as-d-ufin abrid i wammus
rregmat i d-yeţsiffin
ɣellint-d qqaren drus
ussan-nni i d-izerrin
d amdan i ireffden yesrus
Isenni deg awalen
yal ameslay d asurif
azmumeg deg icenfiren
iles-ines mi d-yesḥissif
di tmurt-a idderwicen
i yas-d-ugmen d aɣilif
Nedda amecwar yid-s
isḥerḥer-aneɣ di tikli
d ifeg n iferelles
gar wass-a d yiḍelli
ziɣ d adal i ɣ-itekkes
nekkni i- wumi terreẓ tmuɣli
Mi s-nesla s lexbar amcum
yeqqim yimi d ameltax
d iɣeblan i ɣ-d-rennun
neḍmeɛ ahat d akellex
deg akal mi t-ţeẓzun
aQbayli yemḍi yefsex
Allaɣ d ameẓyan maḍi
ɣas agerbuz yebda ikennu
afus yezga d acali
deg tamaziɣt i yeţaru
yeǧǧa-yaɣ deg yir tizi
neţa yennumen d usalu
Ɣur-neɣ s igujilen deg yiles
ulac amedya am neţa
mi ɣ-teɛreq nerra ɣur-es
yeţakk-d kra n tikta
tura aql-aɣ nesulles
yeṭtef-aɣ waḍu di
ssixṭa.
Ɛ.Mezdad,
ass n 28 yebrir 1989.